Tag: Cosmology
Steve Stakland: The Phenomenology of Play: Encountering Eugen Fink, Bloomsbury, 2024
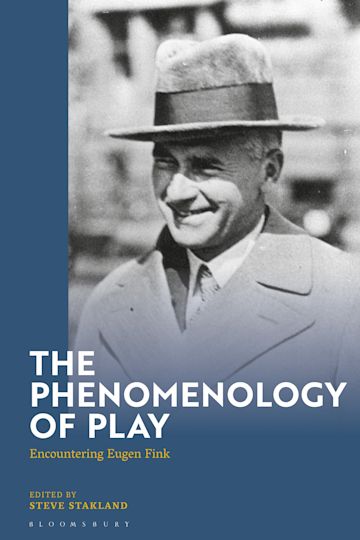 The Phenomenology of Play: Encountering Eugen Fink
The Phenomenology of Play: Encountering Eugen Fink
Bloomsbury Academic
2024
Hardback
264
Guy van Kerckhoven, Giovanni Jan Giubilato: Weltaufgang: die Geburt des kosmologischen Denkens Eugen Finks, Karl Alber, 2023
 Weltaufgang: die Geburt des kosmologischen Denkens Eugen Finks Eine Einführung in den dritten und vierten Teilband der »Phänomenologischen Werkstatt«-Ausgabe
Weltaufgang: die Geburt des kosmologischen Denkens Eugen Finks Eine Einführung in den dritten und vierten Teilband der »Phänomenologischen Werkstatt«-Ausgabe
Karl Alber
2023
Hardback
214
Kristian Larsen, Pål Rykkja Gilbert (Eds.): Phenomenological Interpretations of Ancient Philosophy
Studies in Contemporary Phenomenology, Volume 20
Brill
2021
Hardback €123.00 $148.00
391
Reviewed by: Tóth Réka (SZTE-BTK/PhD, Hungary, Szeged)
Phenomenological Interpretations of Ancient Philosophy is a collection of thirteen essays. At first glance, the title of this book may strike us as somewhat surprising. One may be forgiven for thinking that phenomenology cannot be paralleled with ancient Greek philosophy in a meaningful manner. But, after reading the studies, the reader will undoubtedly come to the conviction that these two types of philosophy have something to do with each other after all. Some phenomenologists tend to view ancient Greek philosophy as if it were the beginning of Western thought, a philosophy that can be seen as a kind of starting point that defines every new thought. According to them, exploring the thoughts of Greek philosophers—or rather just approaching them—can help us understand what the meaning of philosophy is. But it can also help us gain a better understanding of how modern philosophical systems operate — for example, what the ancient foundations of political philosophy, social philosophy, philosophy of science, or even metaphysical research are and how the former impact the latter. On the other hand, many phenomenologists merely undertook to make the ancient Greek texts understandable to the laity, so they try to give a clear description of them. Each of the phenomenological research methods mentioned above appears in the book.
It may seem quite disproportionate that the first five chapters of the book are more about Husserl and Heidegger, specifically an overview of interpretations of ancient philosophers given by these two philosophers. Other chapters contain the approaches of lesser-known or more modern philosophers — the overarching aim of the editors seems to have been to provide an overview of the phenomenological approaches of antiquity. It is important to have insight into this subject, and so far we have not read many books that have dealt with how phenomenology in general could relate to Greek philosophy.
Husserl’s main questions—namely, how to understand the connection between our experience and the world itself, and how to treat science and naturalism—have also raised new questions for later phenomenologists. At the same time, these thinkers were also greatly influenced by Heidegger, especially the way he approached ancient Greek philosophy. Therefore, the work of Arendt, Gadamer, Derrida or other modern philosophers cannot really be interpreted without Heidegger and Husserl.
The first chapter deals with Husserl’s relationship to the Stoics. Within this, Husserl’s interpretation of the term „lecton” is explored by the authors who later turn to Heidegger’s interpretation. In addition to Heidegger’s relationship with Aristotle and Presocratics, they are also talking about the German philosopher’s relationship with the Nazi regime, as this seems inevitable in the present case.
Husserl argued that although the foundations of Western philosophy come from the views of the Greeks, modern philosophers often do not represent the original Greek views, but these ideas are reshaped, rethought or embedded in social philosophy, ethics or other subject areas of philosophy. According to the authors of this book, Husserl believes that Greek philosophy – of course only in its original form – could help diagnose the so-called diseases of contemporary philosophy (3): it is true that it speaks of diseases that often seem to stem from the problems articulated by Greek philosophers themselves. Husserl has a different attitude towards the Greeks than Heidegger — he is generally considered as an ahistorical thinker, but of course this is only partly true. For some reason, however, his opinion of the Greeks have not proven to be nearly as influential as Heidegger’s interpretations. Nevertheless, the editors of the book thought it worthwhile to review Husserl’s ancient philosophical reflections, so we also make a few comments about these ideas based on the book’s introductory explanations.
According to Husserl, not only Plato and Socrates are pioneers of Western philosophy, but Descartes can also be considered a forerunner of modern philosophical methods. So there are actually three pioneers in philosophy and science. Husserl thinks that Descartes can be considered the second forerunner because his response to skepticism is so relevant that it cannot be ignored (6). According to Husserl, despite Plato’s rigor, he failed to overcome skepticism. But Descartes had the same goal as Plato: to deny radical skepticism. According to Husserl, however, Descartes differed from his predecessors in that he tried to explore subjectivity in a scientific way.
Embarking on this path, Descartes wanted to develop an apodictic theory that could not be overturned by any skepticism — thus reaching an ego that, in spite of all other doubts, could not doubt itself. In doing so, he proved an unwitting pioneer of phenomenology, in that he initiates a transcendental turn in philosophy. This is why the authors may think that it is essential to talk about Descartes in a volume that explores the relationship between phenomenology and the Greeks (8). We could also say that Descartes reinterpreted the Greeks and that is why Husserl thinks that modern philosophy begins with the former. According to Descartes, the soul is the first axiom to be considered certain, and from which our knowledge of the world can be derived. However, Husserl thinks Descartes did not take into account the fact that subjectivity also limits the notion of truth.
The authors of the book hold that Husserl—just like Heidegger—deserved more chapters in the volume because, in addition to Heidegger, he was the one who saw this kind of fundamental crisis and this kind of motif in modern philosophy — in his last, unfinished work: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (1936).
Heidegger, in his early twenties, devoted much work to the study of both Descartes and Aristotle. Together with Husserl, they had a tremendous influence on philosophers such as Arendt, Strauss, Klein, Fink, and Marcuse, to name but a few. The authors mentioned above are also included in the book, but the main focus is nonetheless on Husserl and Heidegger, so we also place more emphasis on the presentation of these two philosophers. It is also true that Heidegger himself based his late philosophy (reflections on the history of existence) on these initial researches.
In the following, I would also like to provide a closer look at each chapter. In the first five chapters we read about Husserl and Heidegger, specifically how they approach and deal with Greek traditions.
In the first chapter, we may read Claudio Majolino’s analysis of Husserl (Back to the Meanings Themselves: Husserl, Phenomenology, and the Stoic Doctrine of the Lekton), in which he raises questions as to why Husserl, unlike other phenomenologists, praises the Stoics for their insight. Majolino also attempts to find an answer to the question how Sartre and Deleuze might have thought that Husserl’s interpretation of „noēma” could be paralleled with the „lecton” (meaning of a proposition) of the Stoics. According to the author, none of Husserl’s writings explicitly mentions that the two concepts can be set in parallel. It is simply believed that Husserl combines the two concepts because of structural similarities. Sartre, according to Majolino, draws quite provocative conclusions: the former claims that in his statement about „noēma”, Husserl betrayed his most basic phenomenological claim or discovery: the intentionality of consciousness. This is how Sartre’s judgment sounds:
Husserl defines consciousness precisely as transcendence. This is his essential discovery. But from the moment he makes the noēma unreal, and the noesis correlation correlate of the noēsis, he is totally unfaithful to his principle. (Sartre 1943, 61).
The author then decides to analyze in detail Sartre’s and Deleuze’s thoughts on the concept of lecton. He then notes the distinction between them: Deleuze does not interpret it as a strange physical or spiritual entity like Sartre (33). Majolino performs a fairly precise analysis. We can then learn that although Deleuze refers to some passages from Husserl’s text, it is interesting that in these Husserl himself does not mention the lecton anywhere the noēma appears. So Majolino does not draw a parallel between the two either.
Sartre and Deleuze sought to reconcile Stoic philosophy with phenomenology—especially Husserl’s phenomenology. In retrospect, this seems like a rather difficult undertaking, and the complexity of this task is presented to us by Majolino in convincing detail. He shows that Sartre neglected the propositional nature of „lekta” and confused „noēma” with „ennoēma” (36)—while Deleuze confused the two interpretations of the senses, using them once in a semantic sense and another in a transcendental sense. One of the main questions of the author is then, why does Husserl mention the term lecton so many times and why does he hold the stoic concept to be of such significance? In this study, we see an analysis that is often neglected by philosophers when researching the connections between phenomenology and ancient philosophy. In addition, Majolino helps clarify some unclear concepts about Husserl’s philosophy. The author discusses in detail what the actual significance of the lecton is for Husserl, and also what kind of correlation can be observed between the lecton, the Husserlian conception and formal ontology. After these analyzes, he also discusses how we can derive phenomenology from the Stoics.
The second chapter is composed of Thomas Schwarz Wentzer’s study of Aristotle’s anthropological-political interpretations (Speaking Being: Heidegger’s Aristotle and the Problem of Anthropology). The main purpose of this study is to answer certain philosophical-anthropological questions. In this chapter, the author discusses the question of why Heidegger was so committed to Aristotle and how Greek philosophy in general oriented Heidegger’s way of thinking. This chapter is about how, according to the author, Heidegger related to his predecessor, who takes the same hermeneutical approach to the human question as he does — in particular in De Anima, the Nicomachean Ethics, the Rhetoric, and the Politics. According to Max Scheler, man is characterized by indeterminacy. However, Heidegger finds his way with the help of Aristotle to build his phenomenological anthropology.
In the third chapter, Pål Rykkja Gilbert talks about Heidegger’s interpretation of Aristotle, specifically those dedicated to the latter’s ethics (Virtue and Authenticity: Heidegger’s Interpretation of Aristotle’s Ethical Concepts). It is well known that Heidegger devoted much time to understanding Aristotle in his first works. It is generally accepted that phronesis is one of the most important concepts in Being and Time. In this chapter, the author first examines some of Heidegger’s passages, those that relate primarily to Aristotle’s ethics, especially the concepts of „phronesis” and „prohairesis”. The author firstly tries to lay out the background of how Heidegger approaches these works and concepts of Aristotle. Secondly, he attempts to compare Heidegger’s interpretation with other, more conventional Aristotelian analyses. Thirdly, he also strives to answer the question of whether Heidegger “ontologizes” Aristotle’s ethical project. To this he replies that it is incorrect to say that the Aristotelian concepts were transformed into Heidegger’s „Ontological” concepts. The author approaches the problem mainly on the basis of parts of the Nicomachean Etics and De Anima, displaying excellent knowledge of these Aristotelian works. Gilbert identifies one thing as the main concept of Aristotle: the concept of prohairesis. According to him, an understanding of prohairesis is an essential part of understanding the Aristotelian phronesis and, in general, what he claimed about virtues.
We can read Charlotta Weigelt’s study of Heidegger’s thoughts relating to the Platonic concept of truth in the fourth chapter (An “Obscure” Phenomenology? Heidegger, Plato, and the Philosopher’s Struggle for the Truth of Appearance). The author bases her analysis on the 1930s lecture text: On the Essence of Truth: Plato’s Allegory of the Cave and “Theaetetus” from 1931/2 (GA 34). According to Weigelt, Heidegger completely rethought the cave analogy and at the same time had a great influence on transcendental phenomenological research. Weigelt, following Heidegger, analyzes the cave analogy in four parts (139). According to the author, Heidegger treats the concepts of truth and appearance here as phenomenological concepts. It would also be important to discuss these issues because, in general, Heidegger’s reading of Plato is divisive among historians of philosophy. The author argues that Heidegger saw Plato (as most philosophers) through the lens of Aristotle and that is why he does not pay much attention to Plato’s dramatic contexts and Socrates, but merely analyzes Platonic works literally. But of course sometimes we have to ignore these while reading Heidegger, because in the meantime he says important things about the Platonic concept of ideas. The author bases her findings mainly on Metaphysics, Physics and The Sophist.
In the fifth chapter, Hans Rubin explains Heidegger’s notion of „moira” among others (A Strange Fate: Heidegger and the Greek Inheritance). The author conducts his analysis based on what was said during the Parmenides courses. He admits that this series of lectures adds a much to Heidegger’s notions of „destiny”, „fate”, and „the destinal”, and he thinks it can answer us a lot about why Heidegger drew so much from Greek philosophy (163). These two concepts, namely „fate” and „destiny”, are strongly interlinked, according to the author, to Heidegger’s political philosophy, and more specifically to his nationalist sympathies. But how can all this be connected with the thinking of Parmenides? In the fifth chapter, we get interesting answers to this question and, among other things, how the concepts of „fate” and „destiny” („moira” and „meiromai”) can be related to our modern globalized world today. The author conducts a very thorough examination, uses certain parts of Homer’s Iliad, Plato’s notion of moira, and is very critical of Heidegger’s late works.
We again read a study related to Plato in the sixth chapter (Dialectic as a Way of Life: Hans-Georg Gadamer’s Interpretation of Plato). In this section, Morten S. Thaning conducts research on Gadamer’s analysis of Plato. He wants to find out how Gadamer approached the Platonic dialectic. According to Thaning, Gadamer’s aim in analyzing Plato’s dialectics is, on the one hand, to shed light on significant elements of Aristotle’s critique of Plato. On the other hand, the author not only researches Gadamer in this respect, but also asks on what Heidegger might have based the idea that Plato was a forerunner of the Western metaphysical tradition. It also turns out that Gadamer was passionate about the Platonic method, and that he thought Plato should be interpreted as a practice of philosophy in the Socratic sense (182). In addition, the chapter also discusses how Gadamer’s theory of dialectics can be described. Moreover, we can see an interesting subchapter in which the author seeks to figure out how Socrates’s self-confessed ignorance (Nichtwissen) reshapes the Platonic concept of knowledge and the relationship between dialectics and knowledge (179). But the main question is what is the essence of philosophy in the Socratic sense and how is the dialectic of Socrates is related to the hermeneutical experience in the Gadamerian sense? According to the author, Gadamer has an excellent grasp of the language of Plato’s dialogues, and for this reason he thinks we should examine the concept of Platonic knowledge together with the dialectical language itself and understand one through the other.
An interpretation of Plato follows in the seventh chapter (Counting (on) Being: On Jacob Klein’s Return to Platonic Dialectic). In this section, the author, Kristian Larsen delves again into the topic of dialectics. He tries to summarize and rather rethink Jakob Klein’s interpretation, which deals with Platonic dialectics as a method. According to Jens, modernity, as a kind of second Platonic cave, alienates us from ourselves and the world (203). Larsen finds a good basis for this idea in Jakob Klein’s thoughts on the distinction between ancient and modern science and philosophy. The main purpose of this study is to show and thoroughly delineate these differences. In addition to this, he also discusses in this study how Klein’s distinctions (ancient and modern science) resemble or differ from the views held by Heidegger and Leo Strauss. Comparing these three thinkers, the author concludes that Klein is essentially in agreement with Heidegger and Husserl, for all three hold, because of the anxiety and alienation in modernity, that it is the duty of Western philosophy to return to the Greeks. A significant part of the terms used by the Greeks have been radically reinterpreted (and misunderstood) in the modern age. The author links his research to this position. He argues that Klein and Strauss have many points in common about the relationship between modernity and Greek philosophy and also shows these common points in his study. We have to think here about modern (especially late-modern) philosophy. The practical usefulness of the study may also be to try to answer questions such as: how can we deal with our prejudices against capitalist societies and transform our overarching sense of alienation from modern society?
In the eighth chapter, Husserl’s analysis takes center stage once more (Phenomenology and Ancient Greek Philosophy: Methodological Protocols and One Specimen of Interpretation). Burt Hopkins analyzes Husserl’s concept of intentionality through the research of Jakob Klein. Hopkins examines Klein’s analyzes in which he discusses the differences between the Greek ontology and the Cartesian sciences. The author pays special attention to Greek works in this study, but primarily analyzes one of Klein’s 1936 studies entitled “Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra” (Klein 1934, 18−105). In addition to examining Klein’s interpretations (including the study of the concept of „arithmos”), the author also provides an in-depth analysis of Husserl’s concept of intentionality. In addition, we can see a detailed textual analysis of that section of Plato’s The Sophist, aporia of „Being” („einai”), and parts of Theaetetus, and, as a matter of fact, he also looks critically at the studies published on these works. Hopkins’s study primarily requires a detailed examination of the concepts of „Whole” („holon”), „All”(„pan”), and „All of something” („panta”).
In the ninth chapter, we can read Jussi Backman’s study of Hannah Arendt (The (Meta)politics of Thinking: On Arendt and the Greeks). The philosopher examines Arendt in terms of how she approached ancient Greek philosophy. According to Arendt, the roots of twentieth-century totalitarian regimes go back to ancient Greek philosophical theories, so perhaps we can get obtain a solution to these social problems through the Greeks as well. Arendt’s attitude towards the Greeks can be seen primarily through one of her main works, The Human Condition (1958). In this text, she writes, among others, that Plato’s political philosophy has been transformed. Arendt was discovered in Plato’s mind the phenomena that make philosophy „disgusting” and thus left a mark on the whole tradition of politics. That was „the political turn” according to her, the philosopher returned to the cave and brought rules alien to the laws of human cohabitation for the inhabitants of the cave. It seems that nowadays we interpret the thoughts of the founder of Western philosophy as if it were some kind of tool that would enable us to achieve a higher goal. The author also mentions Arendt’s Life of the Mind (1977−8), in which the philosopher explains how harmless Greek terms (such as the term “fear”) were born thousands of years later than other terms such as “judgment.” The author believes that Arendt explored very precisely the connection between the “thinking” and the “action” of the study of antiquities. He also draws attention to the gap between the two (Arendt uses the terms „vita contemplativa” for the former and „vita activa” for the latter.) The author considers Arendt’s work to be hermeneutics on the one hand (265), because he thinks she tries to interpret our contemporary modes of thinking. On the other hand, it is also very phenomenological, in the sense that it seeks to trace the Greek tradition back to the initial (Greek) experiences from which they emerged.
Vigdis Songe-Møller presents Eugen Fink’s study of Heraclitus and Heidegger in the tenth chapter (Heraclitus’ Cosmology: Eugen Fink’s Interpretation in Dialogue with Martin Heidegger). The chapter revolves around a question that intrigued both Heidegger and Fink: what is the relation between „hen”, „One”, and „ta panta”, „All things”, in Heraclitus’ thinking? According to Fink, this question and the relationship between the two can be explored by examining the cosmology of Heraclitus. The author notes the great similarity between the cosmology of Fink and the Greek philosopher, and explores this similarity in her study, mainly in confrontation with Husserl and Heidegger. Of course, Fink essentially follows Heidegger in his approach to the Greeks and uses his tools in many ways, but he shows uniqueness in his analysis of Heraclitus. The main difference is that „Fink is able to confirm an interpretation of the relation between hen and panta that Heidegger from the very beginning had been critical of.” (300) In order to show the differences, the author presents Fink’s cosmological ideas in detail.
In the subsequent study, Filip Karfik analyzes Jan Patočka’s interpretation of Plato on the soul (Jan Patočka on Plato’s Conception of the Soul as Self-Motion). Patočka argues that the idea of being as „self-moving” can help to understand the whole Platonic philosophy, of which the soul is central. Karfik discovers an interesting paradox by Patočka in his research on the philosophy of the soul. Patočka, according to Karfik, summarizes the whole spirit of Platonic philosophy and provides us with convincing arguments. The author also investigates the phenomenological background of Patočka’s own philosophy and he also attempts to uncover the question of what self-movement has to do with self-determination, based on a reading of Patočka philosophy.
The last two chapters show us how the Presocratic philosophers and Plato influenced the philosophies of Lévinas and Derrida. In the twelfth chapter (Elemental Embodiment: From the Presocratics to Levinas via Plato), the relationship between Plato and Lévinas is examined from a phenomenological perspective by the authors, Tanja Staehler and Alexander Kozin. They investigating this topic because they suggest that the value of Plato’s contribution can best be best uncovered by applying a phenomenological perspective. In general, the authors tend to discuss the differences between Plato and Lévinas, such as how their views on “love” differ. This was investigated by Sarah Allen whose research is thoroughly analyzed by the authors of the study. But the differences were also examined, for example, by Wendy Hamblet, who saw the difference between the two in his conception of the concept of truth. In the present case, however, Staehler and Kozin prefer to emphasize commonalities by focusing on the complex phenomena under discussion. The study is based on an analysis of two key concepts: “eros” and “zōion“.
And last but not least, in the thirteenth study, Derrida’s complex reading of Plato’s Phaedrus is analyzed in detail by Arnaud Macé (Outside the Walls with Phaedrus: Derrida and the Art of Reading Plato). Derrida considers one of his most important own thoughts to be, following Plato’s lead, the view that philosophy cannot be practiced through writing alone (348). According to Macé, Derrida engages in a special reading of Plato, which is called “harmonic,” a term often used by the phenomenologically-influenced postmodern philosopher. According to Macé, the Platonic dialogues are far different from other philosophical writings because of their hidden structural elements, and Derrida collects these elements precisely. Derrida sees the connection between these elements in the term „pharmakon”, a concept with a rich polysemy — „Remedy”, „Poison”, „Drug”, to name a few of its principal meanings. By reading Derrida, we can learn about the non-philosophical elements of Plato that he places in a philosophical context for his own deconstructivist reasons.
In this book we read about the confrontation of many notable authors with Greeks. In addition, it should be mentioned that these authors all seem to have singled out terms from an ancient Greek philosopher that can, arguably, describe the entire oeuvre of a given philosopher. Such was the case with Husserl and Heidegger, among others, who are absolute pioneers in the subject, which is why they were understandably given a bigger role in this book. It is interesting to mention that, although Heidegger’s hermeneutical phenomenology is fundamentally different from Husserl’s transcendental phenomenology, we can still discover some similarities between them. One such similarity can be seen, for example, between Husserl’s reflection on traditions and the crisis of European philosophy of science and Heidegger’s notion of „nihilism” and „oblivion”. At the same time, it seems that Heidegger’s interest in antiquity and Husserl’s philosophy also had a great influence on Arendt, Gadamer, Derrida, Lévinas, Fink, and so on. None of the latter can be interpreted effectively without the philosophy of the former two. Every study composing this book is situated in the context of modern problems, which can go a long way toward clarifying our current situation, deepening our understanding of the contemporary problems we face.
References:
Klein, J. 1934. Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra. Berlin: Verlagsbuchhandlung Julius Springer.
Sartre, J.−P. 1943. Being and Nothingness. An Essay in Phenomenological Ontology. Oxfordshire: Routledge.
Renaud Barbaras: L’appartenance. Vers une cosmologie phénoménologique
 L’appartenance: Vers une cosmologie phénoménologique
L’appartenance: Vers une cosmologie phénoménologique
Bibliothèque Philosophique de Louvain
Peeters
2019
Paperback 28,00 €
VI-111
Reviewed by: Luz Ascárate (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
« Dans l’éclatement de l’univers que nous éprouvons, prodige ! les morceaux qui s’abattent sont vivants » (René Char)
Renaud Barbaras intitule son dernier ouvrage L’appartenance. Vers une cosmologie phénoménologique. Le texte est constitué des leçons données en mars 2019 à l’UCLouvain et reprises dans son cours de Master II du premier semestre de l’année académique 2019-2020 à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Ce texte est une introduction au nouveau projet – qui occupera Barbaras pour les deux prochaines années comme il l’a avoué dans son cours de Master II du premier semestre de l’année 2020-2021 – d’une cosmologie phénoménologique. À vrai dire, nous nous retrouvons au seuil d’une nouvelle période de la philosophie de Barbaras. Dans ce nouvel ouvrage, en posant, tout d’abord, et à nouveau en phénoménologie, la question du corps et de la chair, pour délimiter ensuite la notion d’appartenance, il propose une unité fondamentale entre la capacité phénoménalisante et l’appartenance au monde. La formule ontologique, inspirée de Merleau-Ponty, qui se propose comme soubassement d’une telle unité fondamentale et comme événement originaire de l’étant est celle de la « déflagration », à partir de laquelle l’auteur esquisse une réponse aux problèmes génératifs propres à une cosmologie phénoménologique. Plusieurs problèmes se posent à cet égard. L’appartenance est-elle la notion légitime pour comprendre la phénoménalisation ? Une réponse rapide et négative à cette question pourrait se défendre à partir des critiques husserliennes de l’existentialisme. Si nous essayons de donner une réponse positive à une telle question, une deuxième question se pose. En quoi une ontologie de la déflagration continuerait à être phénoménologique ? Si nous sommes toutefois convaincus que la cosmologie phénoménologique ne trahit pas les motifs fondamentaux du mouvement phénoménologique, une troisième question se fait jour. En quoi consisterait l’originalité de cet ouvrage par rapport aux autres développements d’ontologie phénoménologique ? Afin de donner des réponses à ces questions, nous formulerons les hypothèses suivantes. La notion de déflagration, comme formule de l’arché (principe et origine) ontologique de la phénoménalisation, renouvelle, tout en demeurant fidèle aux fondements du mouvement phénoménologique, d’une part, une branche spécifique de la tradition phénoménologique – la branche proprement française –, et d’autre part, la branche ontologique en tant que telle. Mais par rapport à l’originalité et à la spécificité de la cosmologie barbarasienne, nous soutenons qu’à la différence d’autres ontologies phénoménologiques, la cosmologie phénoménologique de Barbaras ne surgit pas de la critique de la subjectivité transcendantale husserlienne (Fink et Patočka), ne finit pas par un négativisme de l’être (Sartre, Jaspers, Jonas), pas plus qu’il ne se subsume dans une onto-théologie phénoménologique (Heidegger, Lévinas et Marion). La cosmologie phénoménologique de Barbaras défend à la fois l’appartenance du sujet au monde et le caractère phénoménalisant du sujet. Le pouvoir phénoménalisant de l’étant n’est ainsi ni négatif ni neutralisant, sinon profondément vivant. Cette cosmologie trouverait ainsi à s’exprimer poétiquement, comme il l’a lui-même affirmé lors de son cours de Master II en 2019-2020 à Paris I, dans les vers suivants de René Char : « [d]ans l’éclatement de l’univers que nous éprouvons, prodige ! les morceaux qui s’abattent sont vivants » (Char, 1969, p. 153).
I. L’ontologie dont la phénoménologie a besoin
Tout se passe comme si la cosmologie phénoménologique de l’appartenance donnait réponse à la question ouverte par Ricœur sur le type d’ontologie conséquente avec la phénoménologie (1990, p. 345-410). Selon celui-ci, la question de l’ontologie n’a pas été résolue dans la phénoménologie, étant donné qu’une telle solution finirait par dissoudre la catégorie de l’altérité. En effet, la cosmologie phénoménologique de Renaud Barbaras est la toute dernière formulation d’une question ontologique générale dont la réponse a été donnée, comme Ricœur semblait l’attester (1990, p. 410), depuis le commencement même de la philosophie, avec Parménide. Partant, nous sommes d’accord avec le jugement d’Etienne Gilson lorsqu’il écrit :
Il est évident que, tout élément du réel généralement concevable étant un être, les propriétés essentielles de l’être doivent appartenir à tout ce qui est. Lorsque Parménide d’Elée fit cette découverte, il atteignit une position métaphysique pure, c’est-à-dire infranchissable à toute pensée qui s’engagerait dans la même voie, mais il s’obligeait du même coup à dire ce qu’il entendait par « être » (Gilson, 1948, p. 24).
Parménide s’engage, selon Gilson, dans une voie métaphysique qui l’oblige à définir les termes de son ontologie. Si Ricœur ne va pas plus loin dans la question de l’ontologie, c’est parce qu’en suivant Husserl dans la mise entre parenthèses de l’ontologie, sans vouloir la nier, il la déplace dans le point d’arrivée promis qui, comme idée en sens kantien, guide, en son absence et sans faire partie de, la description phénoménologique. Précisément, par rapport à la crainte de l’ontologie que certains phénoménologues ont héritée de Husserl, Gilson remarque le contraste entre « le soin minutieux ou même le génie » des phénoménologues et « l’insouciance avec laquelle ils déblaient sommairement en quelques pages des problèmes métaphysiques dont les conclusions, acceptées par eux à la légère, compromettent parfois ensuite l’exactitude de leurs analyses et en faussent toujours l’interprétation » (Gilson, 1948, p. 22). Nous croyons toutefois qu’avec de telles sentences, Gilson n’adresse pas une critique de fond à la phénoménologie. A contrario, il félicite la rigueur phénoménologie tout en faisant une critique constructive de la méthode. Davantage, il admet l’urgence d’une phénoménologie réformée en avouant que notre temps a besoin « d’une métaphysique de l’être conçue comme prolégomènes à toute phénoménologie » (Gilson, 1948, p. 21). La cosmologie phénoménologique de Barbaras, dont le livre que nous commentons ici n’est qu’une introduction à un nouveau projet, promet, à notre avis, de prendre au sérieux les problèmes métaphysiques en nous offrant, finalement, l’ontologie que la phénoménologie, selon Gilson, a besoin. Ces problèmes nous conduisent au paradoxe, non résolu auparavant dans la tradition phénoménologique, que constituent notre appartenance au monde et la capacité de phénoménalisation de ce monde même.
Mais cette ontologie n’est possible que parce que le versant ontologique du mouvement phénoménologique, en dépit de Husserl lui-même, a posé à nouveau la question de l’ontologie sans en tirer toutes les conséquences. Ce versant commence, à juste titre, avec Max Scheler. Pour lui, la phénoménologie se réalise dans une ontologie qui pose la valeur (Wert-sein) comme être originaire de l’existant (Scheler, 2004). L’existence n’est pas ici mise entre parenthèses comme chez Husserl. Dans tous les cas, pour les deux, il y a une différence entre une attitude mondaine et une attitude phénoménologique. La corrélation intentionnelle serait l’évidence qui apparaît, pour chacun, dans l’attitude phénoménologique. C’est ici la découverte de l’intentionnalité par Brentano (Brentano, 2008, p. 102) qui inaugure le chemin vers une ontologie phénoménologique dans laquelle l’être sera considéré à partir de l’existence intentionnelle que la Modernité avait perdue. Pour Barbaras, l’intentionnalité est « l’envers centripète du mouvement centrifuge de la déflagration, la manière dont se réalise et se manifeste l’appartenance dynamique à l’événement originaire » (p. 80). Il souscrit ainsi à la position phénoménologique fondamentale qui rapproche Scheler de Husserl. Cependant, Barbaras fonde l’intentionnalité au seuil de l’être lui-même. Il ne s’agit pas d’une structure de la conscience dans les termes de Brentano, mais d’une structure ontologique fondamentale entre l’être et l’étant qui n’exprime que l’appartenance de l’étant à l’être est le caractère essentiel, non restrictif, de l’être se déployant dans l’étant.
Nous sommes convaincue que la phénoménologie est capable de révéler cet aspect intentionnel et foncier de l’existence parce qu’elle est elle-même une question qui prend la forme d’une réponse à une question dérivée : la question sur le comment (quomodo). La phénoménologie décrit le comment de la chose et en décrivant elle demande le quoi, le quid, un quid qui ne se donne jamais dans l’exercice de la méthode phénoménologique. La question sur le quid ne peut être résolue que par une ontologie, l’ontologie que Husserl a mise entre parenthèses, et que Heidegger, Lévinas et Marion diffusent dans une onto-théologie sans rendre assez compte de la capacité phénoménalisante du sujet, parfois subsumée dans une éthique. Pour sa part, Scheler place l’ontologie comme vrai fondement de la philosophie en incluant la catégorie de « monde » dans la dernière période de sa pensée. La capacité phénoménalisante du sujet semblerait toutefois se diffuser dans l’ordre des affectivités. Un versant criticiste de la phénoménologie fait dériver la question ontologique (quid) de la critique opératoire de la description phénoménologie (quomodo) tout en récupérant la catégorie de « monde ». Ce sont Fink et Patočka qui, en parcourant une voie criticiste, réintroduisent la question cosmologique déjà posée par Scheler. En tout cas, c’est cette même ontologie phénoménologique visée par l’ontologie négativiste de l’existentialisme, que Ricœur situe comme finalité promise par la méthode sans jamais y arriver (la voie longue), et dont la route est inaugurée par Merleau-Ponty sans pour autant être accomplie. Barbaras appartient sans doute au même mouvement phénoménologique qui pose la question du quid dans le même site originaire que la question sur le comment (quomodo). Nous pouvons affirmer à juste titre qu’il appartient au mouvement phénoménologique tout court.
Il y a néanmoins deux manières d’appartenir à un mouvement philosophique, lesquelles sont, corrélativement, deux manières de rendre possible la continuité et postérité de ce mouvement. La première est de rester fidèle à l’idée authentique du fondateur du mouvement en le défendant contre ses critiques et ses interprétations abusives, en montrant que sa pensée est encore importante dans un contexte philosophique toujours nouveau. Il s’agit de l’option exégétique du mouvement phénoménologique, qui continue à chercher, dans l’œuvre non publiée du fondateur, des réponses aux problèmes contemporains. La deuxième consiste à renouveler les fins qui ont mobilisé un tel mouvement philosophique à partir de nouvelles questions et de nouvelles réponses. Il s’agit de l’option créatrice qui implique toujours la formation de nouvelles branches. Les deux manières sont, d’une certaine manière, impliquées dialectiquement dans la pensée de Barbaras. Il est évident que l’apport de Barbaras n’est pas exégétique, mais sa proposition renouvelle cette tradition tout en y étant fidèle. Nous pouvons lire sa trajectoire philosophique à partir du geste phénoménologique dans la mesure où, en prenant comme point de départ les présupposés théoriques précédents (dans ses premiers ouvrages, voir par exemple, Barbaras, 1991 et 2004) pour les neutraliser et rendre possible la vision du phénomène (dans les ouvrages précédant ce dernier, voir par exemple, 2011a et 2016a), il amène, dans la toute dernière période de sa philosophie (2019), l’ontologie phénoménologique à sa formulation la plus radicale, en en tirant toutes les conséquences.
II. Le versant français de l’ontologie phénoménologique
La pierre de touche de L’appartenance. Vers une cosmologie phénoménologique de Renaud Barbaras est indubitablement la notion de déflagration comme origine cosmologique de l’ontologie de l’appartenance. Il s’agit d’un concept qui permet de mettre l’accent sur le caractère vital, dynamique et spatial de cette ontologie. En ce sens, même si ce livre inaugure une nouvelle étape dans la philosophie de l’auteur, il est conséquent avec les découvertes de l’étape précédante de sa philosophie qui a été déployée depuis Dynamique de la manifestation (2013) jusqu’à Métaphysique du sentiment (2016a) et Le Désir et le monde (2016b). Dans ces œuvres, nous trouvons un effort pour penser la radicalité de la corrélation d’une phénoménologie dépassée par une métaphysique. Dans L’appartenance. Vers une cosmologie phénoménologique, c’est surtout la perspective cosmologique qui sera traitée comme la plus fondamentale et la plus originaire. Cette perspective met la catégorie de l’espace comme étant plus fondamentale que la catégorie du temps, bien que cette perspective, comme l’a fait remarqué Aurélien Deudon (2018), ait déjà redémarré dans les ouvrages antérieurs de l’auteur : « force est de conclure que le temps est la forme même de l’apparaître secondaire, tout comme l’espace était la forme de l’apparaître primaire » (Barbaras, 2013, p. 327).
L’importance donnée à l’espace nous permet de penser dans les termes avec lesquels Guy-Félix Duportail caractérise la phénoménologie française, comme traversant un moment topologique (2010). De ce fait, Benjamin (2018, p. 115) nous a averti de l’être spirituel (ein geistiges Wesen) transmis par tout usager d’un langage constitué au sein d’une culture. Ainsi, sans vouloir risquer un historicisme, nous pouvons postuler que chaque phénoménologue français déploie des traits propres aux différentes couches de sens que nous comprenons par philosophie française, si nous rapportons la tradition phénoménologique française à l’histoire plus générale de la philosophie française. Selon Camille Riquier (2011), la philosophie française trouve son origine dans la figure de Descartes. Il ne se réfère pas à cette origine dans des termes causaux ou ontologiques, mais comme un simple fait :
[I]l n’y a pas de philosophe français qui ne se soit retourné vers Descartes à un certain moment de son parcours, souvent décisif, pour éprouver sa pensée au contact de la sienne, ou pour reprendre un fil qu’il avait laissé interrompu, s’y rattacher et le prolonger. Le caractère fondateur qui lui a été reconnu de droit au regard de toute la philosophie moderne a masqué l’importance toute spéciale que les penseurs français lui ont toujours accordée, de fait, dans leur propre édification intellectuelle. En France, Descartes est un référent plus encore qu’une référence, qui fournit moins les idées que la trame qui servira à les ordonner, – ce qui n’est pas le cas ailleurs (Riquier, 2011, p. 3).
Riquier identifie trois voies cartésiennes suivies par les philosophes français, dont la première, où l’on peut situer les phénomènologues français, est celle du cogito. Ceux-ci auraient pu exploiter ses ressourses aux marges de la phénoménologie transcendantale uniquement « à la faveur du cogito de Descartes qui était là pour eux, derrière, plus large que celui de Husserl » (Riquier, 2011, p. 23). Les œuvres de Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur et Barbaras ne seraient que le prolongement, selon Riquier, du sentiment de l’union de l’âme et du corps avec lequel le cogito cartésien déborde celui de Husserl en lui contestant sa prétention d’auto-fondation absolue (Riquier, 2011, p. 23). Force est de dire que la phénoménologie de Husserl n’a pas été reçue sans des conditions pré-compréhensives par la philosophie française. Cela peut expliquer que, comme l’affirme Bernard Stevens, la tradition de la phénoménologie française ait sauté de manière trop rapide aux réflexions de la Krisis, justement le livre plus « ontologique » de Husserl. À cela s’ajoute l’importance des réflexions sur la chair présentes dans Ideen II, livre qui a été aussi bien reçu par l’école française de phénoménologie, à la différence des Méditations cartésiennes, livre accusé souvent de solipsisme par la même école. De plus, Frédéric Worms remarque l’avènement du moment du vivant (Worms, 2009, p. 560) vers la fin du XXe siècle dans la phénoménologie française. Même si ce vivant apparaît sous la forme d’un bergsonisme minimal, dont le côté maximal est apparu au début du siècle.
Renaud Barbaras renouvelle ces préoccupations que nous pouvons qualifier de « proprement françaises » : le point de départ de sa cosmologie phénoménologique est la reconsidération radicale du corps, tout en échappant à une manière idéaliste de penser la chair comme conséquence d’une perspective ontologique fondée sur la conscience. Ce point de départ est inspiré de Merleau-Ponty même si son ontologie de la chair délivre les coordonnées du problème plutôt que la solution (p. 12), en risquant un dualisme sous-jacent à la distinction entre la chair mienne et la chair du monde. En allant plus loin que Merleau-Ponty, Barbaras essaie de résoudre le problème du dualisme que pose toute phénoménologie de la chair, et du solipsisme que pose toute phénoménologie. Comme Barbaras le montre, dans le premier chapitre du livre intitulé « De la chair à l’appartenance » (p. 1-26), la réflexion philosophique a manqué l’expérience foncière du corps au moment où elle l’a identifiée. Bien qu’un certain type d’ontologie ait déjà réfléchi sur la question du corps, celle-ci n’a pas été prise radicalement, car, au lieu d’être question, le corps est assumé comme une réponse (p. 13) au cœur d’une ontologie déjà donnée. Barbaras réalise ainsi une épochè des ontologies, qui ont caché le corps, sédimentées dans l’attitude naturelle. L’une de ces ontologies est l’ontologie de la mort sédimentée dans la science contemporaine pensant le corps du point de vue de l’inertie. Ce qui apparaît dans l’effectuation de cette épochè est une expérience fondamentale : l’appartenance. Pour Barbaras, penser le corps comme problème fondamental n’est rien d’autre que de mettre en avant la dimension d’appartenance. Afin de comprendre cette dimension de manière ontologique, l’auteur exerce deux remaniements ontologiques radicaux : a) la conscience n’appartient pas au monde ; elle est une modalité, parmi d’autres, de cette appartenance (p. 16); b) le fondement ontologique premier est l’espace et non le temps, comme une certaine perspective ontologique et phénoménologique l’a présupposé en prenant l’espace comme un dérivé du temps (p. 21). Ces deux remaniements ontologiques sont strictement liés car apparaître consiste à déployer l’espace. C’est pourquoi, seulement en prenant comme point de départ l’espace, nous pourrions saisir le sens phénoménologiquement radical de cette appartenance. Ainsi, Barbaras se place, à la fois, dans le moment topologique de la phénoménologie française, tout en utilisant les outils de la phénoménologie (l’époché et la description de l’expérience) débordés par l’expérience de l’appartenance. Mais est-ce que l’appartenance est comparable au sentiment de l’union âme-corps que Riquier présume déployé par les phénoménologues français dans le but d’aller plus loin que Husserl, tout en retournant à Descartes ? Nous croyons, tout au contraire, que la notion d’appartenance prouve l’originalité de Barbaras face à la tradition française de la phénoménologie, comme nous le verrons par la suite. Il nous convient ici de poser la question sur le quomodo de l’appartenance. Comment un étant appartient au monde ?
III. L’éclatement du monde
À notre avis, dans la clarification des modalités de cette appartenance, nous pourrons comprendre les conséquences inédites de cette ontologie face aux ontologies antérieures et à la tradition française de la phénoménologie. Précisément, dans le deuxième chapitre du livre intitulé « Les trois sens de l’appartenance » (p. 27-56), Barbaras propose une typologie sémantique. Du point de vue de l’usage français du mot appartenance, trois sens d’appartenance apparaissent : être dans le monde ou le site (être situé, position inhérente à l’étant) ; être du monde ou le sol (être pris dans son épaisseur, là d’où l’étant se nourrit et d’où provient son étantité), être au monde ou le lieu (la phénoménalisation, l’occuper activement, s’investir, une forme de possession du monde). Pour Barbaras, il y a un rapport d’identité entre les trois sens d’appartenance : l’inscription onto-topologique de tel étant dans le monde a pour envers la phénoménalisation du monde dans cet étant. Ces trois sens de l’appartenance ne font donc qu’un seul. L’inscription ontologique d’un sujet situé topologiquement dans le monde est aussi le déploiement de la phénoménalisation. Pour une partie de la tradition philosophique transcendantale, la phénoménalisation du monde est fondée sur la distanciation du monde. Barbaras renverse ce préjugé : plus un étant appartient au monde, plus il le fait apparaître. Le degré zéro de cette appartenance sera représenté par la pierre. L’appartenance de la pierre déploie un lieu, mais à contre-courant des autres êtres vivants : en se concentrant. La vie de la pierre se manifeste alors tout d’abord comme temporalité. Sa spatialité apparaît de manière dérivée et comme défaut : « le défaut de déploiement spatial est l’envers de l’installation dans une durée longue » (p. 32). La plante est, contrairement à l’animal, spatialisation, mobilité pure : « elle est tout entière à l’extérieur d’elle-même » (p. 36). L’animal, au contraire, occupe l’espace sans sortir de lui-même. Or, l’homme est un homo viator (p. 33). Il apparaît au monde dans le sens de la mobilité et c’est le désir de l’homme la raison même de la mobilité. Le rapport entre conscience et sol se pose ici autrement que dans le cartésianisme, de telle manière que le problème même du solipsisme ne se pose pas. Mais tout en demeurant dans le sol français qui contient sa philosophie, Barbaras dépasse Descartes – avec qui, selon Riquier, les phénoménologues français dépassent Husserl – avec Bergson. Dans l’un des moments les plus poétiques du livre, l’auteur s’aligne avec Bergson pour distinguer entre un corps minime et un corps immense. D’un point de vue solipsiste, notre corps serait la place minime que nous occupons, qui renfermerait la conscience. Du point de vue de Bergson, selon Barbaras, si je suis là où la conscience peut s’appliquer, mon corps va jusqu’aux étoiles. Plus radicalement, en dépassant Husserl et Descartes, pour Barbaras, « ce mode de déploiement du lieu qu’est ici la conscience des étoiles repose sur l’appartenance ontologique du sujet aux étoiles, sur le corps immense, et vient réduire la tension entre le site, à quoi correspond le corps minime et le sol, qui n’est autre que le cosmos lui même » (p. 55). Autrement dit, les étoiles deviennent lieu parce qu’elles sont d’abord sol. La conscience appartient premièrement à un corps pour être elle-même conscience, et au monde, ou aux étoiles, advient le caractère essentiel de pouvoir être phénoménalisé pour un sujet qui y appartient. La question du quomodo va se métamorphoser ici dans les termes du quid à des niveaux différents. Comment tout en étant différent des étoiles pour les percevoir, nous les faisons paraître en ce que nous appartenons à une continuité avec elles dans le sol ? Quelle ontologie fondamentale serait-elle capable d’expliquer, en répondant au quid de l’être, l’unité et la différence au sein de cette nouvelle manière de penser l’appartenance ? En d’autres termes, la question est de donner réponse à l’origine ontologique (quid) de la phénoménalité. Dans les mots de Barbaras avec lesquels commence le troisième chapitre du livre intitulé « Vers une cosmologie : la déflagration » (p. 57-80), où il essaie de répondre à ces questions, « [i]l s’agit de comprendre pourquoi ce faire singulier [que le mouvement des vivants est un mouvement phénoménologique] dont nous parlons, dont l’autre nom est le désir, ne peut être qu’un faire paraître » (p. 57-58).
Plus exactement, la question est de savoir comment le sol qui se sépare de lui-même par le site donne lieu au surgissement du lieu. Mais le surgissement de la phénoménalisation ne doit pas être compris dans le sens d’une téléologie. Le paraître de l’être est totalement contingent sans pour autant laisser d’être le paraître de l’être. De la réponse à cette question dépend la réponse à une question qui en est dérivée : la question de l’unité de l’appartenance. Il faut pouvoir expliquer comment le sol, en se séparant dans le site, n’est autre que le sol lui-même. En prenant en compte que le sol contient tous les étants en tant qu’il les fait être, cette appartenance est ontologique : les étants ne sont pas seulement situés dans le monde, il constitue leur source, il nourrit l’être de l’étant qui y est inscrit. Il s’agit d’une ontogénèse dynamique surabondante. Cette surpuissance n’a d’autre positivité que dans ce qu’elle fait naître (p. 61) ; elle ne peut avoir rien d’étant pour être la source de tout étant. Le sol est donc accessible uniquement dans l’étant qu’il dépose, étant l’acte de déposer. Il est le jaillissement comme être et non un être qui jaillit. Barbaras admet qu’il ne s’agit pas de la puissance aristotélicienne « toujours référée à une substance et ordonnée au telos de l’acte », mais plutôt de la puissance plotinienne qui est Acte, débordement de l’Un qui donne ce qu’il ne possède pas (p. 61). Mais cette surpuissance ontogénétique ne doit pas diffuser le caractère spatial de l’appartenance : si l’être n’a pas d’autre sens que l’appartenance, produire n’est qu’installer dans l’extériorité. La puissance onto-génétique disperse, donne un site. Le site s’inscrit ainsi dans une surpuissance expansive. Le sol, étant la surpuissance expansive, produit le multiple dans son être jaillissement. Plus que monde, l’être est Nature au sens d’une physis originaire. En suivant Dufrenne (1981, p. 165), Barbaras remarque que la Nature indique, d’un côté, l’extériorité et l’antériorité du monde comme précédence ontologique, et, d’un autre côté, l’énergie de l’être comme puissance ou productivité. Cette formule exprime le monde de l’appartenance à la fois comme totalité antérieure extériorisante et comme surpuissance productrice. À ce titre, la phénoménologie qui prend ce monde-Nature comme objet ne peut se réaliser que comme cosmologie.
Arrivé à ce point, Barbaras est capable d’expliquer la mobilité de l’étant, une autre voie pour comprendre la nature du sol. La raison du mouvement est la distance du site au sol. Mais le site est contenu dans le sol : « sa distance au sol est distance au sein du sol » (p. 65). La mobilité de l’étant provient alors du sol. L’étant ne produit pas la mobilité, il s’y insère. Dès lors, le mouvement des étants témoigne de la nature de son sol. Le sol serait, selon Barbaras, la mobilité même (archi-mobilité, pur jaillisement). À dire vrai, c’est le sol qui, en tant que puissance ontogénétique, essaie de se rejoindre à partir de ce qu’il produit : de revenir à lui au travers des étants en lesquels il se sépare. En s’inspirant de Louis Lavelle (1937), Barbaras affirme que la participation ne fait pas de l’étant une partie du Tout. L’être n’est pas préalablement réalisé, mais l’étant participe à un acte qui est en train de s’accomplir grâce à une opération qui oblige l’étant à la fois d’assumer sa propre existence et l’existence du Tout. Autrement dit, la puissance ontogénétique à laquelle appartient l’étant n’existe pas en dehors de ses produits « et leur doit en ce sens son être » (p. 68). L’étant rejoint son sol par un mouvement désirant parce qu’il s’insère dans l’acte onto-originaire qui est en train de s’accomplir et qui lui donne l’énergie qui lui permet de déployer un lieu au sein du même sol qu’il essaie de rejoindre. Cela peut évoquer une affirmation d’un autre livre de Lavelle (1939) publié en aval de celui cité par Barbaras : « Elle [la vie] est toujours un retour à la source. Elle fait de moi un être perpétuellement naissant » (Lavelle, 1939, p. 92).
En voulant éclairer cette source qui est le sol, Barbaras pose à nouveau la question de Leibniz dans Les Principes de la Nature et de la Grâce : « pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien » (Leibniz, 1996, p. 228), dans des termes cosmologiques : « comment y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » (p. 68). Cependant, il ne s’aligne ni sur Sartre ni sur Husserl, qui donnent, soit à l’existence, soit à la conscience, une irréalité ou négativité métaphysique, seule capable de dépasser le réel, de le penser ou de le constituer. Pour Barbaras, la négativité se pose uniquement en des termes ontiques. La source est une et indivisible : elle produit le multiple parce qu’elle ne l’est pas (négativité ontique). Mais elle n’est pas non plus un néant. Il n’y a pas création ex-nihilo. Il y aurait une forme de précession métaphysique : « rien de moins que la surabondance qui sous-tend tout étant pour autant qu’il vient à l’être » (p. 70). Sa négativité ontique consiste en son excès métaphysique. Il faut alors la comprendre comme l’événement en tant que mondification qui est l’advenir même d’une multiplicité d’étants (avènement). C’est pour cette raison que Barbaras choisit de caractériser cet archi-événément, sens d’être ultime du sol, comme déflagration. La déflagration est éternelle, car l’étant est immobile dans son archi-mobilité et stable dans son instabilité constitutive (p. 72). Barbaras avoue qu’il identifie ici, dans le concept de déflagration, l’archi-mouvement et l’archi-événement qu’il avait distingués dans son œuvre précédente (voir Barbaras, 2013). Ce qui nous permet d’affirmer que nous nous trouvons, en effet, au début d’une nouvelle période de la philosophie de l’auteur.
La déflagration peut aussi répondre aux problèmes touchant l’advenir du multiple. La déflagration est dispersion originaire qui renvoie à une pluralité de sites ou, autrement dit, à des étants individués et différents. Il y a autant de multiplicité numérique, spatiale, que de multiplicité qualitative : différence. Cette différence n’est autre que la gradation inhérente à la déflagration. Les étants s’éloignent différemment de leur source, « de telle sorte que la déflagration est naissance de différences dans la différence » (p. 75). En empruntant des expressions avec lesquelles Bergson explique l’évolution de la vie (1908, p. 108), Barbaras caractérise la déflagration comme l’éclatement qui est gerbe ontologique créant des directions divergentes, ce qui donne lieu à l’individuation de l’étant. C’est l’événement même de la contingence comme fait de la différence renvoyant à la contingence absolue de l’avènement de la déflagration comme absolu. Les éclats que sont les étants sont retenus dans leur propre avènement. Ils sont maintenus dans leur source, l’écho de l’archi-événement les transit éternellement sous la forme de la mobilité. Les différences entre les étants s’expriment donc en termes dynamiques, et la mobilité n’exprime que la proximité avec la surpuissance originaire. Effectivement, René Char n’a jamais si bien expliqué – rétrospectivement et de manière aussi fidèle – l’intuition philosophique rapprochant Barbaras et Bergson : « les morceaux qui s’abattent sont vivants » (Char, 1969, p. 154).
Plus précisément, dans le cas des vivants, leur mobilité exprime leur proximité ou leur degré d’insertion dans la déflagration. A contrario, l’immobilité de la pierre exprime un éloignement de l’éclatement originaire. Dans le cas de l’étant humain, connaître son sol exprime sa proximité à son sol. En termes simples, tout mouvement de l’étant est mouvement vers le sol, « quête ontologique » (p. 79). Barbaras se situe à l’opposé du transcendantal husserlien ou du distancement intellectuel cher à la phénoménologie : la pensée, la donation du sens, la réflexion, et pourquoi pas, la description phénoménologique, auraient pour source et condition de possibilité une profonde inscription dans le sol. Malheureusement, Barbaras n’explique pas ici les conséquences épistémologiques de cette cosmologie déflagrationniste pour une théorie de la connaissance renouvelée.
La déflagration barbarasienne est, partant, l’ontogenèse dynamique, la puissance ontogénétique, l’archi-événement capable de produire le multiple sans déchirer l’unité fondamentale des étants, l’archi-mouvement stabilisant. L’inspiration merleau-pontienne de l’idée de la déflagration est évidente : « Tel est à nos yeux le sens véritable de ces mots que Merleau-Ponty ajoute à propos de cette ‘explosion stabilisée’ qu’est ‘absolu du sensible’ : ‘i.e. comportant retour’ » (p. 79). La déflagration doit se comprendre alors dans les termes d’une explosion qui ne cesse jamais d’exploser. Les étants ne se séparent jamais de cette déflagration ; ils sont au seuil même de sa puissance et « reviennent sans cesse à elle, mettent à profit la puissance dont ils héritent pour rejoindre l’origine, recoudre la déchirure » (p. 79). En amont, dans L’Œil et l’esprit (1964), Merleau-Ponty a caractérisé la recherche de Cézanne de la profondeur dans les termes de la déflagration de l’être :
La profondeur ainsi comprise est plutôt l’expérience de la réversibilité des dimensions, d’une « localité » globale où tout est à la fois, dont hauteur, largeur et distance sont abstraites, d’une voluminosité qu’on exprime d’un mot en disant qu’une chose est là. Quand Cézanne cherche la profondeur, c’est cette déflagration de l’Être qu’il cherche, et elle est dans tous les modes de l’espace, dans la forme aussi bien. (…) Elle (la couleur) est « l’endroit où notre cerveau et l’univers se rejoignent », dit-il dans cet admirable langage d’artisan de l’Être que Klee aimait à citer (Merleau-Ponty, 1964, p. 65-66).
Pour Barbaras, la profondeur sera la manière dont le sol se phénoménalise comme tel, l’envers phénoménal de la déflagration. Mais celle-ci ne s’abolit pas au profit de ce qu’elle dépose, elle explose en comportant retour. Ceci ne veut pas dire qu’il y aurait deux mouvements : la retombée de l’étant est remontée. Le mouvement centrifuge de la déflagration dans l’étant est aussi le mouvement centripète de l’étant vers la déflagration. C’est dans ces termes qu’il faut comprendre que le site appartient au sol comme le multiple à la déflagration, de manière que le site n’est pas le sol mais n’est pas autre chose que le sol. L’intentionnalité comme déploiement d’un lieu à partir d’un site ne serait que la manifestation phénoménologique de l’inscription et du retour de l’étant vers son origine explosive. L’intentionnalité est donc la manifestation centripète du mouvement centrifuge de la déflagration, la réalisation de l’appartenance dynamique à l’événement originaire (p. 80). Le lieu est, enfin, la trace phénoménologique de la continuité ontologique qui demeure dans la séparation. La question de la phénoménologie se pose ici. Nous retournons à la question sur le comment : l’origine des lieux. Quelle serait la phénoménologie de la cosmologie de la déflagration ? Dans le quatrième chapitre intitulé « La genèse des mondes » (p. 82-109), Barbaras fera le point sur la phénoménologie d’où il vient (Merleau-Ponty, Husserl et Patočka) pour poser les termes de la phénoménologie vers laquelle il se dirige et qui demeure ici en état de promesse.
IV. La phénoménologie que la cosmologie mérite
Au début du quatrième chapitre, Barbaras rappelle sa critique de l’ontologie phénoménologique de la chair de Merleau-Ponty. Cette conception présuppose une limitation que la cosmologie phénoménologique essaie de dépasser : « contrairement à ce que Merleau-Ponty affirme, que cette chair soit mienne, c’est-à-dire sentante, ne signifie d’aucune manière qu’elle se distingue de la chair du monde : c’est au contraire en tant que chair du monde, en tant par conséquent qu’elle lui appartient radicalement, qu’elle est mienne » (p. 81). La condition de la phénoménalisation est l’inscription phénoménologique dans le monde. La question classique de l’union de l’âme et du corps, qu’on a qualifié au début de cet article de purement française, est ici dépassée. Si ma chair est la chair du monde, j’ai une conscience signifie la même chose que j’ai un corps et inversement (p. 81). La distinction entre conscience et corps est une abstraction. Cela lui permet de répondre aussi à Husserl. C’est la profondeur de l’inscription dans le monde qui mesure la puissancce phénoménalisante et non l’inverse. Le faire paraître le monde n’implique pas une situation d’exception, mais une appartenance radicale à lui. Barbaras renverse ainsi également la qualité d’être éjecté du monde du Da-sein heidéggerien ou de l’être pour soi sartrien : « c’est pace que ce que nous nommons conscience est du monde en un sens plus radical que d’autres étants, qu’elle est précisément conscience, à savoir aptitude à le faire paraître » (p. 81). L’extériorité est inscrite au sein de cette nouvelle interprétation de la phénoménalité. En effet, l’ampleur du lieu n’est que la profondeur de l’inscription dans le monde. Un nouvel a priori universel de la corrélation, valide pour tout étant, apparaît : « autant d’appartenance, autant de phénoménalité ; autant de continuité ontologique, autant d’ipséité » (p. 82). Mais la question est de savoir comment comprendre le statut et l’origine de la phénoménalité. Afin de répondre à cette question, Barbaras montrera que la phénoménalisation consiste dans l’unité propre à la manière dont les étants remontent vers leur source.
Le début de sa démonstration est inspiré de la phénoménologie a-subjective de Patočka. Ce phénoménologue, auquel il a consacré deux livres auparavant (2007, 2011b), dépasse de manière définitive la phénoménologie transcendantale de Husserl – que Barbaras caractérise comme « la version orthodoxe de la phénoménologie » (p. 83) – en déliant la phénoménalité de l’étant de la référence à un sujet constituant. Cela ne veut pas signifier la perte absolue du sujet. Le sujet sera dérivé d’une conception non subjectiviste de la phénoménalité. Selon la critique de Patočka (1995) à laquelle Barbaras souscrit, Husserl n’aurait pas su respecter l’autonomie du champ phénoménal dévoilé par l’épochè phénoménologique. Plus précisément, il finirait par trahir l’épochè. En effet, l’attitude naturelle peut être comprise par l’intention de rendre compte de l’apparaître du monde à partir des lois du monde ou, dans d’autres termes, de tenter de rendre compte de l’apparaître à partir d’un apparaissant. Mais Husserl, tout en voulant suspendre l’attitude naturelle, fait reposer pourtant l’apparaître sur des vécus (un apparaissant). Il faut donc faire avec la conscience ce que Husserl fait avec la thèse du monde, la neutraliser, afin de pouvoir accéder à l’apparaître comme a priori ultime. Cet a priori ne sera pas distinct de celui des apparaissants mondains : l’apparaître est un et relève d’une même légalité. Pour Patočka, c’est le monde qui constituera ainsi l’a priori ultime de l’apparaître, étant le vrai point d’arrivée de l’épochè. C’est l’appartenance au monde le sens d’être ultime de l’étant. Le monde est l’apparaissant ultime : « la condition du donné est un archi-donné » (p. 87). Autrement dit, le monde est l’a priori de l’expérience du monde : l’empirique, ou plutôt l’ontologique, et le transcendantal coïncident. Il semblerait que Patočka finisse par faire dériver l’apparaître de l’apparaissant, comme il le reproche à Husserl. Cependant, selon Barbaras, ce n’est pas le cas si on comprend bien le sens de cet apparaissant qui est le grand Tout, qui est le monde. Pour s’expliquer, il reprend et renverse la détermination husserlienne de la perception comme donation par esquisses. La perception se déploie sous la forme d’un cours d’esquisses parce que l’on dispose par avance de la garantie de pouvoir parcourir la chose. Il a fallu que la continuabilité de cette expérience me soit donnée d’emblée : une chose ne paraît qu’au sein de son horizon. L’horizon n’est plus, comme pour Husserl, potentialité de la conscience. La présence intuitive doit se comprendre comme la cristallisation d’un horizon préalable. L’horizon sera le nom de l’être donné à la continuabilité de l’expérience : l’Un englobant. Dire d’une chose qu’elle apparaît signifie qu’elle s’inscrit dans une unité ouverte de toutes les apparitions possibles. L’expérience est ainsi en continuité avec toutes les autres l’expériences. À dire vrai, elle ne peut être qu’une : l’unité de l’expérience est ce qui commande son être d’expérience. La conscience n’est donc pas la condition de l’apparaître, elle serait la conséquence de l’apparaître : c’est dans la mesure où une chose apparaît dans une totalité englobante que l’unité peut se donner à une conscience et non l’inverse. S’il ne s’agit pas alors d’une conscience, la question qui se pose est celle du mode d’être de ce sujet capable d’accueillir cette unité.
Barbaras le confesse : « [l]es mots ici nous manquent (p. 92). Sans le deviner peut-être, il s’aligne sur les moments de description de phénoménologues qui, en voulant être fidèles à la description des aspects les plus mystérieux de l’expérience, rendent explicite les limitations du langage. C’est peut-être en ceci que réside la différence entre la phénoménologie et l’herméneutique, ou encore entre la phénoménologie et le structuralisme. Nous en trouvons l’un des exemples dans les descriptions husserliennes de la constitution de la conscience absolue du temps. Et c’est justement l’excédance du moyen de description par les faits phénoménologiques de la description même qui en dit le plus long sur la pratique fidèle de la phénoménologie et de la profondeur de la vision du phénoménologue. Scheler remarque précisément que la phénoménologie montre avec la parole ce qui doit être expérimenté par l’interlocuteur du phénoménologue, une expérience qui dépasse les moyens de l’expression de l’évidence (Scheler, 1954, p. 391). Dans tous les cas, il est aussi étonnant que compréhensible que les mots manquent quand Barbaras essaie d’éclairer le sens de l’être de ce sujet phénoménalisant. Selon Barbaras, ce sujet ne peut pas être constituant, mais il est requis par l’apparition qui le précède comme principe d’unification. Le sujet participe, dans l’unification de l’unité unifiante, de l’apparaître des choses sans les constituer. La réponse de Barbaras, en accord avec la cosmologie de la déflagration, est que le sens d’être de ce sujet consiste en un mouvement, « précisément celui qui constitue cette unité des apparitions que nous avons, pour notre part, nommée lieu » (p. 93). L’horizon des apparitions existe comme son propre déploiement dynamique indifférent au partage de la transcendance et de l’immanence. En suivant Patočka, Barbaras remarque que la pénétration dans le monde est l’envers d’une orientation qui implique que le sujet soit situé au sein de la totalité : « l’approche est toujours un ‘déloignement’ (Entfernung) » (p. 94). Mais c’est parce que l’approche constitue notre rapport originaire au monde dans un tout anticipateur, que nous voyons les choses ; le distancement n’est pas la condition de possibilité du voir. La phénoménalité est renvoyée, par Barbaras, à la mobilité. L’unité est effectuée par un sujet qui, appartenant au monde, s’avance vers son sol au sein de lui en déployant des lieux. Patočka a déjà mis l’accent, selon Barbaras, sur le caractère spatialisant de la phénoménalisation. Toutefois, le pas franchi par rapport à Patočka consiste à fonder cette dynamique spatialisante sur une appartenance ontologique et non topologique, « sur un défaut d’être qui ne peut avoir pour envers qu’une aspiration » (p. 95). Barbaras remet la question de la phénoménalisation dans les termes du lieu au sein de sa cosmologie, afin de donner à l’espace son importance constitutive. Au fond, l’indivisibilité de l’origine perdure sous la forme de la puissance unifiante qui habite chaque étant : son activité phénoménalisante (p. 97). L’unité est la trace d’une telle puissance indivise. La surpuissance de la déflagration demeure sous la forme des mouvements qui s’attestent dans une dimension unificatrice. L’étant poursuit cette unité dans le multiple et tente de la réaliser. La sortie de l’origine comme dispersion a une relation d’identité avec le retour à l’origine comme rassemblement. L’origine de la phénoménalité, l’origine des mondes, est ce qui apparaît de l’origine au sein du multiple, « la manière dont l’indivision de la puissance explosive se réfléchit au sein du fini » (p. 98). La forme est ainsi archè.
Mais si le monde est corrélat d’une appartenance, il y a alors trois sens du monde : le monde comme source (déflagration) qui renvoie au sol, le monde comme multiplicité ontique provenant de cet archi-événement qui renvoie au site, le monde comme forme ou sédimentation de l’origine au sein du multiple qui renvoie au lieu. Ils correspondent respectivement à l’appartenance ontologique, à l’appartenance ontique et à l’appartenance phénoménologique. Si l’étant va de son site vers son sol du point de vue phénoménologique, il y a un mouvement plus originaire par lequel la source explosive cherche à se rassembler dans sa dispersion. Le sujet véritable est le cosmos lui-même et sa vérité est celle d’une surpuissance originaire qui fait des mondes pour se faire être comme pure origine. Le monde proprement dit est, pour la phénoménologie de cette cosmologie, la trace de la puissance de l’origine au sein du multiple, la totalité comme sédimentation, le troisième sens du monde. Autrement dit, bien qu’il y a un cœur archi-événementiel (déflagration) du monde qui constitue son contenu (l’ensemble des étants), en donnant lieu à son contenu contingente, « l’archi-événement est archi-contingence » (p. 101). Il s’agit d’un néoplatonisme inversé, car la réalité de l’Un qui donne ce qu’il ne possède pas est cosmologique au lieu de métaphysique, elle est une réalité indéterminée et indivisible. De plus, si la pensée consiste dans un mouvement de séparation et de remontée (hypostase vers l’Un) qui produit le multiple, dans la perspective de Barbaras, le multiple manifeste originairement une séparation de l’origine, face à laquelle la remontée vers l’origine a le sens d’une unification.
Les lieux marquent la proximité de l’origine dans la distance. Si aucun monde ne peut s’approprier l’origine, il y a toutes sortes de mondes possibles, autant de mondes que d’étants dont l’amplitude se mesure à la profondeur de l’inscription dans le sol qui n’est que la proximité de l’origine. L’ampleur de la synthèse sur laquelle un monde se repose ou la puissance signifiante sera d’autant plus forte que l’étant sera moins loin de son origine (p. 104). Avec cette affirmation, Barbaras se situe à l’opposé de la phénoménologie qui caractérise le sujet comme étant un hors-monde. Pour la cosmologie phénoménologique, autant d’appartenance, autant d’intentionnalité ; autant d’intentionnalité, autant de subjectivité ; autant de proximité avec la déflagration, autant de puissance ; autant de puissance, autant de monde ; autant de monde, autant de subjectivité. C’est parce que nous sommes d’abord des êtres cosmologiques que nous sommes conscients et connaissants. Les degrés de subjectivation renvoient aux degrés d’appartenance. Barbaras avoue que Merleau-Ponty s’est dirigé dans cette direction mais qu’il n’a pas pu fonder son intuition parce qu’il prenait comme point de départ la chair sensible. La chair comme sentir est différente de la chair du monde qui est sentie en ce sentir même (p. 106). Merleau-Ponty n’a pas pu fonder l’univocité dont il a pourtant eu l’intuition. Pour Barbaras, c’est parce que nous appartenons au sol ontologique du monde que nous sommes capables de le phénoménaliser. La subjectivité ne se distingue pas de la puissance phénoménalisante. Il ne s’agit pas de nier la différence, mais de ressaisir la différence, « nier qu’elle repose sur la séparation d’une entité subjective et d’un monde » (p. 107). Mais si la phénoménalisation ou la subjectivité a pour condition l’appartenance, elle n’a pas l’appartenance pour contenu. Le lieu n’est pas le sol, mais la manière dont le sol se donne à celui qui en est séparé au sein du sol. Le monde est la manifestation de l’archi-événement à celui qui en est un éclat. Partant, « le destin de l’origine est sa propre occultation dans le phénomène » (p. 108). En d’autres termes, la phénoménalisation implique une occultation. Le sol n’apparaît jamais comme sol et c’est pour cela qu’on peut dire qu’on est séparés en son sein. La dimension d’occultation s’accuse tandis que la phénoménalisation se fait plus ample. Le lieu que nous déployons est plus loin du sol. La profondeur de notre appartenance déclenche une puissance de phénoménalisation qui nous permet de déployer un lieu en ouvrant le monde lui-même. Ce monde se donne comme « objectif », détaché de l’activité phénoménalisante, et comme délivrant un sens de l’être. La plus grande appartenance débouche donc sur la séparation, car la phénoménalisation finit par nommer l’essence de ce qui est : « la puissance de l’origine débouche sur sa propre occultation » (p. 108). Nous avons alors plus de chances d’accéder à l’appartenance si l’on aborde les modes d’exister ou mondes où le lieu ne recouvre pas encore le sol. Le problème de la réduction phénoménologique se pose ici. Il faut admettre qu’au sein de la relation objective du monde de la vie, et malgré elle, le sol affleure. Il faut admettre que nous sommes d’une certaine manière initiés à notre sol d’appartenance au sein d’une existence qui nous en éloigne, pour transcender ce monde objectif à partir duquel on ne peut pas « exhiber sa propre condition de possibilité » (p. 109). Barbaras finit son livre alors par l’indication d’une réalité à définir qui serait celle de la profondeur, étant le mode sous lequel l’appartenance se phénoménalise dans le lieu. Pour y accéder, il ne faut pas suivre la voie de la subjectivité objectivante, mais celle d’une contestation interne à celle-ci : la voie du suspens de la puissance phénoménalisante. L’interrogation de la profondeur ne pourra s’accomplir, confesse Barbaras, que dans une esthétique. Il semblerait que la phénoménologie que mérite la cosmologie de la déflagration n’ait pas encore été déployée, et qu’elle serait peut-être une phénoménologie de la profondeur au titre d’une esthétique. Nous comprenons cette idée de profondeur dans la lignée de l’affirmation de Borges : « la musique, les états de bonheur, la mythologie, les visages travaillés par le temps, certains crépuscules et certains lieux, veulent nous dire quelque chose, ou quelque chose qu’ils ont dit que nous n’aurions pas dû perdre, ou ils sont sur le point de dire quelque chose. Cette imminence d’une révélation, qui ne se produit jamais, est peut-être le fait esthétique » (Borges, 1952). Cette profondeur ne serait que le mode sous lequel nous éprouvons la trace de la déflagration tout en essayant de donner monde sans pour autant recouvrir le sol au point de le nier. Et c’est pourquoi il nous faudrait ajouter aux vers de René Char avec lesquels nous avons commencé – « dans l’éclatement de l’univers que nous éprouvons, prodige ! les morceaux qui s’abattent sont vivants » (René Char, 158) –, les mots de Paul Veyne : « [i]ls s’abattent sur le monde, ils y reviennent, et ne chutent pas dans le néant » (Veyne, 1995, p. 516).
Références
Barbaras, Renaud. 1991. De l’être du phénomène : sur l’ontologie de Merleau-Ponty. Grenoble : Jérôme Millon.
—–. 2004. Introduction à la philosophie de Husserl. Paris : Éditions de la Transparence.
—–. 2007. Le mouvement de l’existence : études sur la phénoménologie de Jan Patočka. Paris : Éditions de la Transparence.
—–. 2011a. La vie lacunaire. Paris, Vrin.
—–. 2011b. L’ouverture du monde : lecture de Jan Patočka. Paris : Éditions de la Transparence.
—–. 2013. Dynamique de la manifestation. Paris : Vrin.
—–. 2016a. Métaphysique du sentiment. Paris : Cerf.
—–. 2016b. Le Désir et le monde. Paris : Hermann.
Bergson, Henri. 1908. L’évolution créatrice. Paris : Félix Alcan.
Benjamin, Walter. 2018. « Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen », Ausgewählte Werke. Band III. Berlin : Suhrkamp Verlag, p. 114-131.
Borges, Jorge Luis. 1952. Otras inquisiciones. Buenos Aires : Sur.
Brentano, Franz. 2008. Psychologie du point de vue empirique, trad. de Gandillac, 2ème édition revue par J. Fr. Courtine. Paris : Vrin.
Char, René. 1969. Les Matinaux suivi de La parole en archipiel. Paris : Gallimard.
Deudon, Aurélien. 2018. « Réflexions sur l’espace et le temps dans la phénoménologie de Renaud Barbaras », Alter, no. 26, p. 197-212.
Dufrenne, Mikel. 1981. L’inventaire des a priori. Paris : Christian Bourgois.
Duportail, Guy-Félix. 2010. « Le moment topologique de la phénoménologie française », Archives de philosophie, vol. 1, No. 73, p. 47-65.
Gilson, Etienne. 1948. L’être et l’essence. Paris : Vrin.
Lavelle, Louis. 1937. De l’acte. Paris : Aubier.
—–. 1939. L’erreur de Narcise. Paris : Bernard Grasset.
Leibniz, Gottfried Wilhelm. 1996. Les Principes de la Nature et de la Grâce. Monadologie et autres textes (1703-1716-). Paris : Flammarion.
Merleau-Ponty, Maurice. 1964. L’oeil et l’esprit. Paris : Gallimard.
Patočka, Jan. 1995. Papiers phénoménologiques, trad. Erika Abrams. Grenoble : Jérôme Millon.
Ricoeur, Paul. 1990. Soi-même comme un autre. Paris : Seuil.
Riquier, Camille. 2011. « Descartes et les trois voies de la philosophie française », Philosophie, vol. 2, No. 109, p. 21-42.
Scheler, Max. 2000. « Phänomenologie und Erkenntnistheorie », Schriften aus dem Nachlass. Band I. Zur Ethik und Erkenntnistheorie, Gesammelte Werke. Band 10. Bonn : Bouvier Verlag, p. 379-430.
—–. 2004. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik: Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Halle : Niemeyer.
Veyne, Paul. 1995. René Char et ses poèmes. Paris : Gallimard.
Worms, Frédéric. 2009. La philosophie en France au XXe siècle. Paris : Gallimard.
Alison Laywine: Kant’s Transcendental Deduction: A Cosmology of Experience
Oxford University Press
2020
Hardback £60.00
336
Reviewed by: Thomas Nemeth (USA)
Every student of Kant’s thought is familiar with his reflective assertion that the Transcendental Deduction in the first Critique cost him more labor than any other part. The centrality of that presentation for his entire argument coupled with its sheer conceptual difficulty lay behind Kant’s efforts and the attention he afforded to elaborate it correctly. Countless students from his time to our own have themselves spent an inordinate amount of time attempting to follow the train of thought Kant pursued in it. Not just have disagreements surfaced on the actual steps Kant took in the Deduction, but differing opinions arose on how he could best achieve his intended end. We know that even in his own day Kant’s contemporaries were puzzled by the Transcendental Deduction as it appeared in the Critique’s first edition. Kant took the criticism to heart, and in a second edition of the work he gave a completely new version of the argument. Regrettably, what many thought should be the clearest of all presentations in the Critique – owing to its centrality – has been viewed by able scholars over the ensuing decades, nay centuries, as puzzling and obscure, but above all as inconclusive. Whereas many have ventured opinions on the success of Kant’s endeavor, few, if any, have concluded that he succeeded in achieving whatever it is that he had set out to do.
Numerous attempts have been made even in recent years to do what Kant himself seemingly was unable to accomplish, namely to give a clear account of Kant’s argument in the Deduction, quite apart from whether it succeeds or not. Even if we lay aside the presentations in the form of journal articles, the number of book-length studies alone is surprising, even astonishing – and this just in the English language. Fortunately, we have two eminently lucid expositions of Kant’s Transcendental Deduction, namely Guyer’s Kant and the Claims of Knowledge and Allison’s Kant’s Transcendental Deduction, though as the titles suggest the latter is more pointedly directed at explaining Kant’s text than the former. Both, however, are works that no serious student of Kant can afford to ignore. Certainly, there are considerable differences between the two books in their conclusions and their manner of executing their respective projects. Nevertheless, regardless of one’s familiarity with Kant’s text, whether a graduate student trying to understand Kant’s problem for the first time or an accomplished Kant-scholar, both books offer much clarification and many insights. Moreover, both books make ample use of Kant’s writings from his so-called “Silent Decade” and thus attempt to trace the evolution of Kant’s problem in the Deduction from his early “pre-Critical” writings. Now, we have Laywine’s dense contribution to the literature.
Alison Laywine is one of the few scholars who already in 1995 undertook an examination of Kant’s pre-Critical works in considerable depth with the hope of shedding light on the basic tenets of his Critical writings and positions. In that previous work, Kant’s Early Metaphysics and the Origins of the Critical Philosophy, Laywine told us that an understanding of the first Critique’s dichotomy between the faculties of sensibility and the understanding requires an understanding of his earlier position, why Kant adopted it at the time, and what led him to alter it, assuming, of course, that he did. Implicit in Laywine’s train of thought here is that such knowledge of Kant’s development is necessary in order to arrive at Laywine’s understanding of Kant. She and so many others who make similar claims take no account of the fact that others with a different understanding of Kant may not feel the need to turn to Kant’s pre-Critical writings. Given her position regarding just what the Deduction seeks to achieve, her argument for an examination of Kant’s early writings surely would include that he retained the kernel of his early metaphysics but reinterpreted and adapted it to fit those aspects of his philosophy that changed over the intervening years.
In any case, Laywine claims – and not without good reason – that Kant came to realize the inadequacies of his 1770 Inaugural Dissertation and tried during the subsequent decade or so to investigate and establish the limits of human cognition and the role of the respective faculties he delineated within those limits. He argued that what could be known under the conditions of one faculty could not be known under the conditions of the other. Yet unlike in 1781, the year of the first edition of the Critique of Pure Reason, Kant held earlier in 1770 that the understanding through its concepts can cognize things in themselves, whereas things conceived through the senses are representations of things merely as they appear to us. He drew this conclusion from his contention that space and time are formal conditions of our sensibility. The strict separation of the faculties would go on to pose significant issues for him, and the attempt to resolve them led him to his mature system.
Laywine’s newest book essentially takes up where she left off previously, namely with a discussion of a set of Kant’s papers now known collectively as the Duisburg Nachlaβ, written most likely in 1775, and thus just about half-way between the Inaugural Dissertation and the first Critique. Short of paper, Kant often wrote notes on whatever paper was at hand including in the blank areas on letters he received. The so-called Duisburg Nachlaβ is such a set of jottings written in the blank areas of a letter bearing a date. Based on that fact, we know approximately when the note was scribbled. For those interested in the development of Kant’s mature positions, these notes are of great importance, since we have little else by which we can see the evolution of his thought. Although Laywine acknowledges Guyer’s treatment of the Nachlaβ in his own book, she charges him with neglecting Kant’s early metaphysics and with resisting the idealism that she sees present in the Nachlaβ. She, on the other hand, recognizes “some kind of idealism” (19) in them, but in doing so she in effect begs us to ask of her what kind of idealism is it that she sees. We get an answer or, rather, to use her own words, “some kind of” answer, further on in her detailed exposition of the Nachlaβ, where she says that the idealism is not transcendental idealism, but an idealism based on the idea that the cognizing subject intuits oneself directly through an intellectual insight and “bodies” – presumably meaning all else besides the subject – only insofar as they affect me. In this she explicitly sees herself as diverging from Guyer’s reading of the Nachlaβ, according to which Kant’s writing hopes to provide a theory of the a priori conditions of empirical knowledge but without thereby establishing an unbridgeable chasm between the world as cognized and the world as it is apart from our human cognition, i.e., as it is “in itself.” Even if one were to agree with Guyer in his reading of the Nachlaβ, one must wonder along with Laywine what Guyer meant by realism, particularly if he had Kant’s own definition in mind. Kant claimed, after all, to be an empirical realist even while espousing his transcendental idealism. Thus, the onus falls here on Guyer to clarify his position and interpretation – or at least it does on Laywine’s reading of Guyer.
However, even if we agree that Guyer failed to provide such a clarification, this does not absolve Laywine from providing her own account of Kant’s idealism. She writes that based on her reading of the A-Deduction, i.e., the Deduction as found in the 1781 Critique, Kant was an idealist about objects taken as objects of knowledge, but this need not mean that he was a skeptic concerning the external world (137). Clearly in 1781 Kant did not offer, and presumably therefore saw no need to offer, a special refutation of idealism. To Laywine’s thinking, Kant must have been as surprised as anyone that his sheer confidence concerning externality could be questioned. That critics charged him with Berkeleyan idealism forced Kant to add a distinct “Refutation of Idealism” in the 1787 second edition of the Critique. The question, then, is whether Laywine’s understanding of Kant’s idealism as presented in 1781 stands scrutiny given her premise that Kant took for granted the existence of the external world at the time. To be sure, Laywine finds nothing in Kant’s idealism that would disturb his confidence in externality. However, for us the question is whether Laywine’s confidence is itself misplaced. Are there not ample grounds in the 1781 Critique to think that Kant must have recognized the significance of the problem? And since he did not offer a refutation in the first Critique, is it not possible that he was still searching for one? Much, then, depends on the nature of Kant’s 1781 position, to which Laywine writes she will return in §3d (147-150) of the second chapter of her book. Indeed, Laywine there does somewhat return to the issue, albeit only in a footnote, in which she stresses her disagreement again with Guyer’s treatment of Kant’s idealism in the Nachlaβ. Unfortunately, determining Laywine’s own position requires an understanding of Guyer’s in order then to set Laywine’s against it. Certainly, this can be done, but the procedure requires the reader to make the necessary inference. The burden Laywine thrusts upon her readership is not aided by her assertion that Kant’s idealism in 1775 is “something like” (149f) the idealism that Guyer attributes to Kant in 1781. If the two positions are merely “like” each other, then in what way are they different?
Regrettably, Laywine, by her own admission, states that although she will take into account both versions of the Deduction – the A-Deduction and the substantially revised version in the second edition, or B-Deduction – her focus throughout her treatment is on the latter. This may be understandable given the argument she develops, but it does significantly narrow her potential audience, who may want an understanding of the Deduction on the whole, and not just her particular argument. In this respect, Henry Allison’s earlier work, in patiently dealing with both versions of the Deduction, succeeds far better and is far more accessible to a general reader. True, the B-Deduction may be, as Laywine writes, “more perspicuous” (14), but it is for that very reason, then, that one might well expect her to devote more attention to the first version. To be sure, she does not wholly dispense with the first edition tout court. She does draw instructive parallels between passages in the two versions of the Deduction, but she often finds the A-Deduction more convoluted and the argument more ambiguous than in the B-Deduction. An understanding of Laywine’s discussion here is again helped by the juxtaposition of her understanding with that of Allison’s. Laywine states (14) that a second reason for concentrating on the B-Deduction is to show that certain “infelicities” some have seen in the A-Deduction concerning metaphysics are not mistakes that are “ironed out” in the B-Deduction. On the contrary, Laywine believes that they are essential to the Deduction as such.
Laywine’s devotion to the Nachlaβ in the context of the present work concludes with the assertion that it more or less shows that Kant recognized already in the middle of his “Silent Decade” the need for a deduction of the categories, regardless of their number, of the understanding, i.e., for an, in effect, legal argument substantiating the claim that pure concepts in the understanding apply to appearances and do so a priori. Even stronger, Laywine holds that Kant did provide such a deduction already in the Nachlaβ at least in outline. This can hardly come as a surprise to readers familiar with the vast secondary literature. For example, Wolfgang Carl in a paper “Kant’s First Drafts of the Deduction of the Categories” originally read in 1987 to an audience at Stanford University, but published in 1989, noted that Kant had already drafted several versions of the deduction before the 1781 Critique.
In turning to the Deduction itself in the B-Deduction, one of Laywine’s first concerns is understanding what Kant meant by such terms and expressions as “manifold” and “synthetic unity of apperception.” She turns again to Kant’s pre-Critical writings for clarification as to how he employed the word “manifold” previously, hopefully, thereby, throwing light on his use of the word in the Critique. Laywine writes that for Kant every intuition has a manifold, including a priori intuitions. This would seem incontestable, particularly since Kant himself clearly makes that assertion, for example at B160. Whatever the case, Laywine suggests that not everyone recognized this, Dieter Henrich being one.
Particularly since Henrich’s 1969 article on the proof-structure of the B-Deduction, virtually every commentator on Kant’s first Critique has had something to say on whether the B-Deduction presents two distinct steps or two distinct arguments for a single conclusion. The Deduction, in Laywine’s words, is to show that the categories or pure concepts of the understanding “are the formal conditions of thought in the same way that the pure intuitions of space and time are the formal conditions of sensibility” (13). The problem, so to speak, is that the argument of the B-Deduction extends through §26 of the Critique, but the conclusion offered there does not appear to be substantially different from that already presented in §20, where Kant writes that “the manifold in a given intuition also necessarily stands under categories,” the categories being nothing other than the functions for judging (B143). Only by standing under categories is the unity of the sensible manifold possible. Thus, does the first step of the B-Deduction end with the quite brief §20 (B143) and then resume with a second step at §22 or does §22 advance another distinct argument? If what we have here are two arguments for one conclusion, it looks as though Kant was saying you should pick the one that you like best (209). On the other hand, if the B-Deduction consists of two steps, how do the two steps differ?
Laywine writes that she “prefers” to think that the B-Deduction consists of two steps rather than two arguments (209). Stating that one of the two options is preferred is hardly a ringing endorsement of a choice. We can only hope that now having completed her inquiry Laywine is firmly convinced that she made the correct decision. She does realize, though, that having made her choice she must now say what the second step offers to the argument beyond what the first affirmed. Kant provides the answer, or as Laywine herself calls it “an important clue” to the answer, at the beginning of §26. She then quotes one sentence from that section – in her own translation – after which she remarks that its significance lies in its announcement that the “final step” of the Deduction will be an attempt to account for how nature is possible (210). Are we, therefore, to conclude that what sets the “second step” apart from the first is that it finally answers how nature is possible? But, then, the first step, contrary to its appearance, cannot have reached the same conclusion as the second step. Laywine’s answer lies in understanding that Kant uses the word “nature” in two different senses, a material and a formal sense. Laywine finds the material sense given explicitly in Prolegomena §36, where Kant writes that nature is the totality of all appearances, and the formal sense concerns appearances governed by laws so that they form a unified whole. Stated in such terms what is at issue appears simple enough. But interpreting the intricate and puzzling B-Deduction through the lens of the Prolegomena asks us to assume that the twofold sense given in the Prolegomena accurately reflected Kant’s thinking at the time of the Prolegomena – and not one offered for the sake of simplicity alone – but also that Kant continued to maintain the same stance in 1787. That the B-Deduction does indeed hold to the twofold sense of nature is a major task of Laywine’s treatise.
Laywine sees her proposal for understanding the B-Deduction as unique. Henrich, for one, wrote that what Laywine sees as the respective sections of the B-Deduction constituting the two steps in fact do not actually come to the same conclusion. For Henrich, Kant presents two different arguments with two different conclusions. Others have proposed variations. In Laywine’s estimation, Hans Wagner came close to her own by recognizing that the second step focuses on empirical intuition and perception, whereas the first step deals only with intuition as such. While this train of thought leads him to recognize the importance of the question how nature is possible, he failed to exploit this insight. In focusing on how perception is possible, Wagner, in Laywine’s estimation, overlooked accounting for how perceptions can be connected. Certainly, she correctly remarks that without such an explanation of connected perceptions there can be no explanation of how nature is possible. But we may ask of Laywine what more needs to be added to Wagner’s argument to produce her own. The answer is both easy and hard. That is, it can easily be stated as that we must notice the cosmological aspect of the second step, the contribution of a cosmology of experience makes to the completion of the B-Deduction argument.
We know that Laywine puts much weight on this conception of a “cosmology of experience.” After all, it features prominently in her book’s subtitle, and she mentions the expression many times in her text. She tells us on page 87 that such a cosmology – she also calls it a “metaphysics” (3f) – treats experience “as a unified whole of appearances … and tries to establish its conditions of possibility by showing that its unity comes from laws legislated to appearances by the understanding through its categories.” This treatment of experience, allegedly, is conspicuously absent from the first step of the B-Deduction. The emphasis here is on the word “unity,” for it allows us to characterize the world as a whole. Laywine claims that the germ of this conception of a cosmology of experience “informs” Kant’s account of human sensibility already in the Inaugural Dissertation and again is revealed in the Nachlaβ and even in the A-Deduction. Of course, if it is as easy as Laywine says, it is hard to see why the answer to Henrich’s challenge appears explicitly only on page 214, but in her defense she did prepare much of the needed groundwork up to this point. In her own estimation, the hard part of her argument is to make an understandable presentation of what a cosmology of experience will contribute to the Deduction.
Even by her own reckoning, having reached §26 of the B-Deduction, the final section of the argument, Laywine, by her own opinion, has still not been able to clinch the required proof. According to her, to say, as Kant does, that the categories are valid for all objects of experience in B161 is not the same as invoking universal laws to make the unity of appearances possible. But is it? Laywine continues, holding that if we are to speak of universal laws of nature, they must either stem from God, which Kant has dismissed for his purposes here, or from the categories. Kant at B163 wrote that the “categories are concepts that prescribe laws a priori to appearances, thus to nature as the sum total of all appearances. … Here is the solution to this riddle.” Can we say that with this Laywine’s task is complete?
Hermann Cohen, in his own all-too-brief commentary from 1907, found, like Laywine, that these words contained the transcendental question. He found the answer – or so he says – in the distinction between objects and things in themselves, a distinction that Laywine fortunately does not invoke. But she does, like Cohen, find that the solution she seeks lies in the understanding’s self-activity and the imagination. Cohen writes, “Here we see, however, how the imagination and the connection that it creates between sensibility and the understanding make the resolution more plausible. … Thus by means of the imagination nature, as the sum total of appearances, becomes nature, ‘as the original ground of its necessary lawfulness’” (63, B165). Certainly, while there are many nuances that distinguish Cohen’s endeavor from that of Laywine, there is a distinct similarity that Laywine does not so much as mention.
There are certainly many positive points to Laywine’s treatment of the B-Deduction. Not one of them, however, is that her investigation is largely ahistorical. In this too, though, she is not unique. Despite all the scholarship over the more than two centuries that preceded her work, she makes little reference to it. Does she think that her formulation of and solution to the central problem of the Deduction is original as compared to all that has gone before? If it is unique, that would be a stunning claim in light of all of the nineteenth century German scholarship alone, not counting those from the twentieth, some of which she does briefly mentions. But if it is not, in what way does her treatment contribute to what has gone before? Or is she, in effect, saying that each of us should attempt for ourselves unaided by the past to square the circle? Frederick Beiser has remarked with regard to contemporary Anglophone scholarship on German idealism that many of the champions of a normative interpretation of it do not realize that their reading was worked out with greater sophistication and subtlety long ago (10). Can we not draw a parallel comparison to the core message in Laywine’s reading of the B-Deduction – apart from the many details she provides – but referring instead to Cohen’s interpretation?
Undoubtedly, Laywine’s treatment of the Duisburg Nachlaβ in relation to the B-Deduction is a valuable addition to contemporary English-language Kant scholarship. It is this rather than her actual treatment of the Deduction that sets her book apart. It is not an easy read for the casual or beginning student of the first Critique, who might come upon it looking for guidance. But those already quite familiar with the B-Deduction will find a number of observations they will have likely overlooked previously.
References:
Beiser, Frederick C. 2009. “Normativity in Neo-Kantianism: Its Rise and Fall.” International Journal of Philosophical Studies, vol. 17 (1): 9-27.
Cohen, Hermann. 1907. Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft. Leipzig: Verlag der Dürr’schen Buchhandlung .
Alison Laywine: Kant’s Transcendental Deduction, Oxford University Press, 2020
Renaud Barbaras: L’appartenance. Vers une cosmologie phenomenologique, Peeters, 2019
 L'appartenance. Vers une cosmologie phenomenologique
L'appartenance. Vers une cosmologie phenomenologique
Bibliothèque Philosophique de Louvain, 105
Peeters
2019
Paperback 28.00 €
VI-111
Renaud Barbaras: Recherches phénoménologiques, Beauchesne, 2019
Eugen Fink: Sein, Wahrheit, Welt, Karl Alber Verlag, 2018
 Sein, Wahrheit, Welt
Sein, Wahrheit, Welt
Eugen Fink Gesamtausgabe 6
Karl Alber Verlag
2018
Hardback 92,00 €
584

