Diaphanes
2021
Paperback $35.00
272
 Thought Poems: A Translation of Heidegger's Verse
Thought Poems: A Translation of Heidegger's Verse
 Phénoménologie transcendantale: Figures du transcendantal de Kant à Heidegger
Phénoménologie transcendantale: Figures du transcendantal de Kant à Heidegger
 La huella del pasado: Hacia una ontología de la realidad histórica
La huella del pasado: Hacia una ontología de la realidad histórica
Reviewed by: César Gómez Algarra (Université Laval)
L’histoire jette ses bouteilles vides par la fenêtre.
Chris Marker, Sans soleil
Après un travail consacré au problème de la phénoménologie de l’histoire chez Husserl et Heidegger[1], où, malgré tout ce qui séparent ces deux phénoménologues, un rapprochement essentiel était mené à bien, François Jaran se tourne maintenant vers une recherche de nature explicitement ontologique. Cette enquête vient compléter et développer, pour ainsi dire, son travail précédent pour se pencher en profondeur sur le problème de la réalité historique. En quel sens pouvons-nous ou devons-nous parler de « réalité historique » ? Face aux thèses réductionnistes que l’auteur nomme « matérialistes » ou « subjectivistes », celles qui ne considèrent le monde que comme un agrégat de choses physiques auxquelles on ajouterait le caractère culturel, politique ou historique, il s’agit de défendre une conception plus riche de la réalité. Pour cela, il faut montrer que la « réalité » se donne déjà chargée de plusieurs sens, de plusieurs caractères, qu’on ne peut lui soustraire sans la réduire fatalement. La « réalité » n’est donc jamais neutre, elle se donne « déjà teintée » par ces caractères, selon la belle expression que nous trouvons dans l’introduction, et c’est celui d’être historique qui sera analysé en détail dans cette œuvre (21).
Plus concrètement, l’auteur tente d’appréhender le mode d’être d’un étant en tant qu’étant historique. Pour ce faire, la grande majorité du travail conceptuel se fonde sur le projet philosophique de Heidegger, depuis les cours de jeunesse jusqu’à Être et temps. Mais à ce noyau argumentatif du livre précèdent deux chapitres consacrés au néokantisme et à Dilthey, dont le but est de clarifier les bases philosophiques du débat dont surgit l’herméneutique de la facticité et les interrogations du jeune Heidegger. Finalement, et c’est un ajout remarquable, les derniers chapitres sont consacrés à la ré–effectuation (re-enactment) chez Collingwood et à la trace chez Ricœur. Le recours à ces deux auteurs permet de compléter l’analyse en montrant une proximité et familiarité avec le travail de l’historien qui nuance et dépasse largement les positions heideggériennes, trop radicales ou limitées (23). S’il fallait regretter l’absence d’un nom fondamental dans ces investigations, ce serait celui de Gadamer. Cependant, bien qu’aucun chapitre ne lui soit entièrement consacré, ses apports apparaissent à plusieurs moments de l’argumentation, là où, justement, son travail herméneutique s’avère d’une grande clarté et utilité.
*
Les deux premiers chapitres sont donc consacrés au problème de la fondation (fundamentación) des sciences humaines ou de l’esprit, notamment au débat entamé par Dilthey, Rickert et Windelband à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, débat dont l’influence sur le jeune Heidegger est maintenant bien connue. La question, relevant en principe d’une problématique épistémologique et gnoséologique dans le contexte complexe du positivisme et de l’avancée des sciences de la nature, permet à l’auteur, de façon par moments surprenante, d’en tirer des conséquences d’ordre métaphysique. Dès ce premier chapitre, nous trouvons important de souligner une qualité remarquable de l’ouvrage : la capacité à dégager le contenu essentiel de façon très condensée, résumant en quelques pages les problèmes plus prégnants de ces grandes œuvres et des polémiques qui lui sont attachées, tout en redirigeant la question vers l’enjeu principal.
Il s’agit donc de montrer qu’à partir des distinctions développées par Dilthey entre esprit et nature et entre expliquer et comprendre pour préserver la spécificité du savoir propre aux sciences humaines, les réponses des néokantiens ont nourri une problématique sur les différentes façons dont nous appréhendons la réalité. Du refus de Windelband à l’acceptation de ce dualisme ontologique considéré dominant dans la tradition occidentale jusqu’à Hegel, l’auteur en vient à décrire la division logico-formelle par laquelle universel et particulier sont différenciés. Là où les sciences de la nature peuvent émettre des lois générales, les autres sciences devront rendre compte du singulier et irrépétible. C’est donc le cas, entre autres, de la science historique. Puis, avec plus de détails, F. Jaran consacre plusieurs pages à rendre explicite la contribution de Rickert, qui approfondit les concepts antérieurs en insistant sur la différence entre la tendance généralisatrice et la tendance individualisatrice (30). Ainsi, nous avons une seule réalité effective, conçue de double façon : d’une part, à travers la généralisation qui fait de la réalité nature, et d’autre part, de la particularisation qui fait histoire. Ce qui nous intéresse spécialement ici, c’est de voir comment, dans le cadre de ce débat sur la fondation des sciences, l’auteur dégage des thèses sur le mode d’être de la réalité. Malgré ce monisme ontologique constatable chez Rickert, l’essentiel est surtout que l’être humain appréhende cette réalité à travers ses propres moyens : dans cette ordination de la réalité, le néokantien considère les généralités des abstractions, qui seraient dépassées dans le rang hiérarchique par l’objet individuel auquel nous faisons face. Bien que, en termes kantiens, l’individualité « en soi » de l’objet ne soit pas atteignable, les analyses montrent que, malgré tout, l’appréhension de la réalité par le sujet fonctionne grâce à un type particulier d’individualisation. D’où la conséquence suivante, importante pour la suite du livre : la réalité que l’être humain appréhende est plutôt individuelle avant d’être générale et légiférée comme nature (37). Cependant, comme le relève la dernière section du chapitre, à partir des apports de Kroner, le monisme ontologique des néokantiens ne va pas sans difficultés. En effet, considérer la réalité à partir d’une seule dimension implique aussi de dérober la signification individuelle propre aux objets ou événements historiques : un tableau ne serait qu’un amas de matériaux sans aucun sens au-delà d’ajouts postérieurs. Ceci ne correspond certainement pas à sa réalité la plus propre et significative. Malgré tout, et c’est le thème du deuxième chapitre, il ne va pas de soi que l’essai diltheyéen de sauver la spécificité de l’histoire soit réductible, comme il l’était pour les néokantiens, à un dualisme esprit-nature des plus orthodoxes.
En effet, Dilthey a développé plutôt un monisme ontologique de l’expérience vécue (Erlebnis, vivencia). Contre un appauvrissement de l’expérience, il s’agit de redonner une force et une légitimité à celle-ci dans les sciences humaines, passant de la caractérisation du sujet comme rationnel et froid à sa compréhension en tant qu’être historique dans son être propre. Notons aussi que par le biais de cette caractérisation s’éclaire une autre conception de l’être humain, comme étant capable de radicaliser ses tendances naturelles de compréhension vers tout ce qui est historique, afin d’élargir et d’appréhender son champ de connaissance.
L’analyse de la notion d’expérience vécue menée à bien par l’auteur permet de dégager l’originalité de Dilthey dans le contexte philosophique de son époque. Avant toute abstraction, toute différenciation comme celle d’objet physique et de représentation psychique, nous avons la donation de quelque chose de plus originaire : l’Erlebnis dans toute sa puissance. L’expérience vécue se donne immédiatement, avec des valeurs, des sentiments, etc. Et dans le domaine des sciences humaines, dont font partie l’histoire et ce qui est historique, ce sera à partir des expériences vécues que nous, êtres historiques, pourrons avoir accès aux intériorités passées, à leurs mondes vécus et à leur caractère spirituel, à partir des expressions humaines, de ses œuvres et de leur culture. Leur sens et leur signification ne sont surtout pas réductibles à leur limitation dans d’autres sciences naturelles. L’intérêt de ce chapitre est alors de mettre en avant une dimension originaire de l’expérience vécue qui permette de contrer la compréhension matérialiste plus vulgaire, et ce, à travers d’une lecture des thèses de Dilthey qui se veut expressément métaphysique.
Dans les dernières sections, ce point de vue est développé davantage avec la notion d’Innewerden (saisie, se rendre compte de ; percatación). Avant toute différenciation ou abstraction, nous avons donc l’expérience vécue, à laquelle nous avons un accès immédiat : elle se donne avant toute réflexion, de façon préthéorique, sans qu’on puisse parler de distinction entre le « capter » et le « capté ». Autrement dit, il n’y a pas encore de relation entre sujet-objet, pas de rapport de l’ordre de la connaissance pivotant autour de la perception. La prétention de l’auteur, en mobilisant la notion de l’Innewerden, complétée par des références à Heidegger et à Gadamer, qui ont relié le concept au νοεῖν grec en tant que « perception préréflexive », est d’abandonner le cadre épistémologique et la réduction matérialiste de toute réalité au simplement physique. La compréhension de l’Innewerden fait signe vers un des points clés de l’ouvrage et annonce les chapitres suivants sur le jeune Heidegger. En interprétant de façon ontologiquement forte la conceptualisation diltheyéenne, F. Jaran souligne qu’avec l’expérience vécue nous retrouvons une revalorisation de ce qui est significatif, ce qui a un sens, et donc surtout un sens historique, face aux démarches abstractives propres aux sciences de la nature. Dans la mesure où l’expérience vécue est première, plus originaire et précède les démarches épistémologiques postérieures, et contre le privilège moderne de la perception sensible, nous pouvons nous accorder avec Dilthey pour suivre ce fil comme accès à une réalité plus pleine, où l’être humain se tient avant toute distinction ( 62-63).
Ces deux premiers chapitres offrent une pertinente et très claire vue d’ensemble sur la façon dont le problème et ses enjeux étaient posés et seront reçus par Heidegger, et cela, dès ses premiers cours. C’est à partir de cette question que nous passons maintenant à la deuxième partie du livre, donc aux trois chapitres consacrés au projet heideggérien dans ses diverses ramifications.
L’auteur ouvre cette partie en expliquant l’importance de l’histoire et l’historicité chez Heidegger. Particulièrement intéressante dans ce contexte est la citation d’une lettre à Bultmann, où il est question de l’élargissement de la région du domaine d’objets nommé « histoire ». Cet élargissement, dans le cadre du projet ontologique du livre, ne doit pas être compris seulement comme relevant du caractère éminemment historique du Dasein, mais aussi et surtout comme une élaboration versant sur le mode d’être des étants historiques. Les tentatives de dépassement de l’appréhension de la réalité comme Vorhandenheit fonctionnent alors comme fil conducteur, et c’est ce point qui représente la nouveauté heideggérienne ici reprise. Cependant, en suivant ce fil conducteur, l’auteur va préciser aussi l’évolution du questionnement de Heidegger, remarquant le processus génétique qui va de la thématisation de la vie facticielle à l’ontologie fondamentale de 1927.
Pour ce faire, le troisième chapitre (« Penser l’histoire à partir de l’expérience facticielle de la vie ») est consacré plus concrètement à l’analyse des cours de jeunesse, notamment Phénoménologie de la vie religieuse et Phénoménologie de l’intuition et de l’expression. Il s’agit donc de mettre en avant les acquis plus féconds de Dilthey sur l’expérience vécue et sur la vie pour capter le mouvement de celle-ci dans son inquiétude, et donc dans ce qu’elle m’est propre, se séparant davantage des fixations épistémologiques du néokantisme. À partir de cette orientation, l’histoire n’est plus à considérer comme un « objet » du savoir, auquel on applique des concepts généraux, mais doit être saisie dans la facticité elle-même. Mais pour autant, ce qu’est à proprement parler l’historique, sans se borner tout simplement à le voir comme ce qui « a lieu dans le temps », doit être mieux délimité. Ceci permet à Heidegger de critiquer Rickert dans sa quête d’une historicité plus « vivante » et plus originaire, qui nous détermine et affecte de fond en comble. Avant toute étude scientifique et théorique, notre expérience vitale de l’histoire est déjà là (77).
Cependant, si l’histoire surgit au sein de la vie facticielle elle-même, nous devons comprendre la structure de cette détermination, comprendre aussi comment elle se donne dans le Dasein. L’auteur se prête à ce travail en dégageant la pluralité des modes dans lesquels, selon Heidegger, l’histoire se manifeste dans la vie facticielle, élaborant ainsi une hiérarchie fondamentale. Certes, l’histoire peut être comprise comme un savoir que nous étudions en lisant des textes, documents, etc. Elle peut aussi et surtout être conçue comme la totalité de ce qui est passé ou advenu, voir comme une partie significative de cette totalité. Mais ces manifestations ne sont pas aussi originaires, notamment la dernière, puisque, bien que surgissant d’une pensée humaine, elles fonctionnent plutôt comme une idée spéculative et régulatrice, qui ne concerne pas de façon essentielle notre présent. Pour Heidegger, les modes authentiques de l’histoire nous concernent plus directement, nous « dévorent » pour ainsi dire : c’est plutôt l’histoire comme tradition, comme magistrae vita ou, tout simplement, comme la mienne propre. C’est ainsi que nous nous rapportons à l’histoire, que nous apprenons d’elle. Et c’est là un point essentiel pour son projet ontologique que l’auteur souligne dans ce chapitre : ces rapports à l’histoire sont caractérisés de plus authentiques, dans la mesure où celle-ci se donne ainsi comme existant facticiellement, comme une réalité historique (85-86). Cependant, les réflexions heideggériennes sur le problème ne s’arrêtent pas ici, dans le terrain de la vie facticielle, et vont acquérir un caractère plus ontologique à partir de la reprise du débat Dilthey-Yorck. C’est le thème du quatrième chapitre : « Placer Dilthey sur le terrain de l’ontologie ».
Dans les années 1924-25, s’acheminant vers la question de l’être qui sera décisive par la suite, l’interrogation sur l’histoire et l’historicité se concrétise en partant de façon explicite du traitement d’un étant qui est caractérisé par l’histoire : le Dasein en tant qu’être que nous sommes. Heidegger reprend ainsi, notamment dans les conférences sir Le concept de temps, la philosophie de Dilthey et les critiques du comte Yorck pour modifier le traitement de la vie, passant ainsi à une considération sur les structures ontologiques de l’existence humaine, qui est d’emblée et essentiellement historique. Par ce biais, il va s’éloigner davantage des limites de l’approche propre à la théorie de la connaissance. L’enquête historique ne peut pas partir du privilège de la perception, omniprésent dans la philosophie moderne et dans les sciences de la nature, mais de ce qui est vécu. Réélaboré par Heidegger, le travail sur la vie que Dilthey avait mené doit être maintenant progressivement ontologisé. Il s’agit donc d’une opération de déplacement qui ramène la vie et la réalité historique à sa constitution ontologique, à ses modes de donation. Nous devons, comme le prône Heidegger dans ces textes, nous questionner sur l’être et non sur l’étant, sur l’historicité et non tout simplement sur ce qui est historique. S’offre ainsi une méthode d’interrogation qui n’est pas réductible au traitement de ce qui est vorhanden : c’est seulement ainsi que l’histoire pourra être traitée de façon effective.
Cependant, cette nouvelle approche implique surtout de comprendre l’historicité au sein du Dasein lui-même, donc de se demander en quoi celui-ci est un être essentiellement historique. Ce que veut souligner l’auteur dans ces pages est comment, en comprenant la façon dont tout rapport du Dasein à l’étant est déjà marqué par l’histoire, nous pouvons accéder, à travers cette marque du passé, à une nouvelle prégnance de la réalité historique. En effet, le philosophe fribourgeois s’efforce d’écarter l’idée traditionnelle selon laquelle le passé serait un présent sans actualité, sans être. Contre cette idée bien inscrite dans notre conceptualité depuis Augustin, Heidegger rétorque que le passé se donne sous une forme particulière : celle du Gewesen-sein, de l’être-été (ser-sido). C’est ce statut d’être qu’a le passé, et non celui de présent prétérit, qu’il faut garder à l’esprit pour une recherche sur l’ontologie historique. Ainsi, en 1924 un jalon fondamental était déjà placé, qui sera complété dans Être et temps afin de mieux comprendre quel rapport entretient le présent avec l’historicité.
Le chapitre se clôt par une analyse des conférences de Kassel et de sa reprise dans le cours du semestre d’été 1925, les Prolégomènes pour une histoire du concept de temps. Le recours au premier texte sert à montrer comment Heidegger établit la distinction, devenue désormais « canonique », entre l’histoire comme savoir ou science historique (Historie) et l’histoire comme événement (Geschichte), et un événement qui nous concerne au premier plan. Dans le second texte, il est plus facile d’apprécier le chemin vers une ontologie. En laissant derrière-lui les approches de la vie facticielle, qui ne voulaient pas trancher entre le domaine de la nature et celui de l’histoire, Heidegger souligne néanmoins la possibilité d’approcher la réalité historique vraie, en procédant par une démarche phénoménologique qui capte sa constitution originaire. Mais cela ne sera possible que si l’ontologie grecque, qui relie la présence constante, la oὐσία, à l’être, est rompue par une nouvelle ontologie capable de rendre compte de l’histoire au-delà de cette réduction. Le chemin vers Être et temps est maintenant dégagé, où F. Jaran voit la solution heideggérienne au problème de l’ontologie de l’historique.
Le cinquième chapitre, « L’histoire dans le cadre de l’ontologie fondamentale », se penche alors sur l’opus magnum de 1927. En se concentrant particulièrement sur les paragraphes 72 à 77 de la seconde partie, l’auteur cherche à mettre en lumière le sens et la portée de l’historicité originaire du Dasein dans ce qui l’intéresse davantage : son rapport à l’étant. Pour abandonner radicalement l’idée du présent comme réalité et les thèses subjectivistes de l’histoire il faut tirer toutes les conséquences de la structure temporelle du Dasein, son rapport à l’historicité. En effet, celui-ci n’est pas de prime abord anhistorique pour, par après, se voir octroyer ces qualités : il est de façon essentielle marqué par le temps, et donc le temps arrive (geschehen) en lui, de la naissance à la mort. Dans le questionnement ontologique du livre, il nous faut cependant comprendre aussi comment cette historicité se rapporte à ce qui n’est pas le Dasein.
L’auteur consacre alors une partie du chapitre à commenter l’analyse de l’antiquité, en tant qu’étant historique par excellence, telle qu’elle se déploie dans Être et temps. Cette première approche confirme d’abord l’idée qu’à travers un étant ancien nous avons accès à un monde passé, un monde qui n’existe plus mais qui appartenait à un Dasein, et qui maintenant s’ouvre à nous à partir de cet étant lui-même. Ce monde est caractérisé comme welt-geschichtlich, comme ce qui est mondain-historique (mondo-historial dans la traduction d’E. Martineau). Mais cette façon de considérer le problème n’est pas suffisante : le fil de l’antiquité ici suivi permet de découvrir la relation des étants intramondains comme étants historiques avec un monde aussi bien historique. Malgré tout, il nous reste à comprendre en quel sens plus précisément le monde a lieu comme historique et quelles conséquences nous pouvons tirer par rapport à l’étant historique tel quel.
Ici, la difficulté que l’auteur souligne conséquemment tient à ce que Heidegger lui-même a affirmé dans Être et temps, à savoir, qu’une recherche ontologique de ce qui est « mondain-historique » suppose d’aller au-delà de la recherche qui est la sienne. F. Jaran cherche alors à expliquer ce point et à faire comprendre qu’on ne peut malgré tout ni soutenir que l’histoire est une région ontologique parmi d’autres ni que le caractère historique est simplement un mode d’être à ajouter à la liste que forment la Vorhandenheit, la Zuhandenheit et les autres. Au contraire, l’historicité, pour ainsi dire, se décline historiquement et est à retrouver dans plusieurs modes d’étants, soit subsistants, utiles, existants, etc. (137). Et c’est dans le cours de 1927 sur Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie que Heidegger lui-même jette une nouvelle lumière sur la question. Une des particularités de l’étant historique est son caractère nécessairement intramondain : contrairement à l’étant naturel, qui surgit de et à partir de lui-même, l’étant historique est produit (comme le seraient, dans l’exemple de l’ouvrage, les produits de la culture, etc.), et produit de façon nécessaire par un Dasein. L’étant historique comme intramondain relevant donc de l’intervention d’un Dasein comme causalité ontique, la question ne peut pas être complètement résolue dans une recherche sur les structures ontologiques de l’étant, et donc sur les conditions de possibilité de compréhension de l’être telles que constituent le projet de l’ontologie fondamentale.
Pour conclure ce chapitre et bien exposer les acquis et les voies malgré tout ouvertes de la pensée heideggérienne, l’auteur se tourne vers les remarques « métontologiques » des textes postérieurs à 1927. Compte tenu que la projection transcendantale de l’historicité originaire du Dasein sur l’étant est insuffisante pour expliquer l’étant dans son caractère historique et son appartenance au monde, ce pas est cohérent et semble fécond. De ce point de vue, le retournement vers l’étant comme point de départ permet de penser la manifestation de l’étant comme d’emblée historique. Malheureusement, Heidegger ne traite pas en détail ce thème, se bornant à quelques remarques. Ceux-ci s’avancent vers la possibilité d’une ontologie de l’histoire qui s’appuierait sur le problème du mondain-historique, et a fortiori si elle ne veut pas s’épuiser dans la projection transcendantale du Dasein et de sa compréhension de l’être. En effet, comme le relèvent les dernières pages du chapitre, le caractère mondain-historique ne correspond pas, tout simplement, à un mode d’être qui déterminerait que l’étant se manifeste sous telle ou telle forme. Bien au contraire, l’étant historique se donne dans le monde lui-même, et dans sa particulière référence aussi bien au monde passé du Dasein qu’au problème du monde en tant que tel. Ayant dégagé ce point fondamental pour son projet, F. Jaran peut maintenant compléter sa recherche ontologique en s’appuyant, dans une troisième section, sur des auteurs doués d’une sensibilité différente à l’histoire.
Le sixième chapitre est donc consacré à R. Collingwood, et bien que sautant à l’analyse d’un philosophe et historien anglais, l’auteur souligne que la source des influences demeure la même : Dilthey. Par rapport aux avancées antérieures, Collingwood met en avant la conception de la ré-effectuation (re-enactment) comme mode de reconstitution historique, que F. Jaran va expliciter en comparaison avec la répétition heideggérienne d’Être et temps. Il s’agit alors de bien appréhender comment l’historien est capable de redonner une certaine effectivité aux événements passés, et quel sens épistémologique précis cela possède dans sa recherche.
À partir de ces interrogations, la question est de voir comment Collingwood envisage la possibilité de connaître l’histoire, en admettant que c’est un objet qui dépasse certainement ce qui est « réel », et qu’elle est douée d’un statut d’idéalité et d’inactualité qui doit se révèler malgré tout comme accessible par le travail de l’historien. Ce qui intéresse particulièrement l’auteur est de voir précisément comment cette réactualisation de l’effectivité de l’histoire se déploie, notamment dans une perspective ontologique : c’est par les étants ou artefacts historiques que nous pouvons comprendre les propos humains qui les sous-tendent, les nécessités auxquelles il répondait.
Plus concrètement, Collingwood propose une division entre aspect externe et interne de l’étant historique, donc entre sa dimension physique et psychique, et octroie la primauté absolue de l’interprétation à ce qui est interne en tant que lieu des intérêts humains. L’activité critique de la ré-effectuation consiste alors à repenser dans l’esprit de l’historien ce que les personnages historiques ont dû penser, redonnant une effectivité au passé qui serait justifiée par la capacité humaine de penser la même chose. C’est à ce niveau que tient une des difficultés majeures de la ré-effectuation : la justification de cette mêmeté du pensé doit dépasser l’irrépétable, comme les perceptions et les sentiments, mais elle doit atteindre un sens intemporel de l’événement qui aurait acquis réalité dans le monde.
Cette dimension de la ré-effectuation pose problème ; elle risque de constituer une sorte de phantasme de résurrection absolue du passé dans le présent, apparence qui se radicalise davantage par la position de Collingwood sur la justesse et l’adéquation totale de ce qui est ré-effectué. Contrairement à l’herméneutique, dans laquelle F. Jaran n’a cessé de puiser les ressources de son argumentation, les thèses du philosophe anglais mènent à une compréhension du passé qui pourrait être caractérisée par une certaine naïveté : nous, comme chercheurs, nous recréons dans notre esprit ce qui s’est effectivement passé, tel quel. Face à cela, les travaux de Heidegger, mais aussi et surtout de Ricœur et de Gadamer nous ont montré à quel point la distance historique est un abîme infranchissable qui permet justement une compréhension autre des événements, tout en écartant les soupçons de psychologisme, dont sa présence chez Collingwood est difficilement contestable.
Et c’est donc sur Ricœur que porte le dernier chapitre, où la réponse précise au problème global de l’ouvrage est atteinte. Il s’agit pour l’auteur de voir en quoi la thématisation de la trace, présente dans le troisième volume de Temps et récit, constitue justement ce qu’une ontologie de la réalité historique cherche depuis le début de l’ouvrage. Pourquoi ? Principalement car la visée de Ricœur correspond à ce qui était recherché, notamment parce que la trace relève d’une dimension ontique, elle est bel et bien un « reste visible » qui fait partie de ce qui est arrivé, donc de l’événement historique.
En outre, la trace dépasse les autres étants capables de nous révéler quelque chose du passé, puisque dans sa neutralité elle n’est pas suspecte, comme le monument ou le document, d’être entachée par une forme ou une autre d’idéologie. Bien plus, F. Jaran souligne que dans son rapport à l’événement, la trace a un statut ontologique spécifique : il y aurait un certain rapport de métaphoricité, d’évocation de ce qui est arrivé dans le document, en tant que signe qui fait signe vers quelque chose d’autre, tandis que la trace reste, dans toute sa simplicité, une chose parmi les choses.
À travers cette notion de trace, nous sommes aussi amenés à une critique des limites de l’antiquité et de la position heideggérienne dans Être et temps. En effet, Ricœur cherche à réenvisager cette primauté de l’originaire dont l’œuvre de Heidegger semble porter l’étendard : la trace, par le dérivé et l’ontique, enrichit la compréhension originare de l’histoire et nous montre que l’historicité du Dasein et le savoir historique (Historie) se déterminent mutuellement beaucoup plus qu’ils ne s’opposent. Mais la trace dépasse aussi l’unilatéralité de la conception de Collingwood, qui privilégie l’aspect interne des étants au détriment absolu de l’extériorité, de l’étantité historique de la trace. En elle-même, la trace est la preuve matérielle de la prégnance de l’histoire. Elle n’est pas, telle quelle, une représentation d’autre chose, mais elle « tient lieu de ». Elle garde sa dimension ontique manifeste tout en permettant d’atteindre l’histoire, nous révélant pleinement ce qu’était le but recherché tout au long du livre : ce qu’est un étant historique, une réalité historique en soi qui va au-delà de toute projection subjective et de toute réduction scientifique. La trace nous permet alors d’accomplir notre désir, « un peu puéril » comme le souligne l’auteur, mais néanmoins essentiel pour nous, êtres historiques : celui de « pouvoir toucher avec les mains ou voir avec les yeux un objet qui provient du passé » (175).
[1] François Jaran. 2013. Phénoménologies de l’histoire. Husserl, Heidegger et l’histoire de la philosophie. Louvain: Peeters.
 The Metaphysics of German Idealism: A New Interpretation of Schelling's Philosophical Investigations into the Essence of Human Freedom and Matters
The Metaphysics of German Idealism: A New Interpretation of Schelling's Philosophical Investigations into the Essence of Human Freedom and Matters
 Memoirs
Memoirs
Reviewed by: Sarah Horton (Boston College)
Johan de Jong’s The Movement of Showing opens with the observation that “Hegel, Heidegger, and Derrida consistently characterize their thought in terms of a development, movement, or pathway, rather than in terms of positions, propositions, or conclusions” (xix). In other words, they do not stake out a definite position that they defend against all comers; rather, they call attention to the movement that carries us beyond each apparently fixed position that a work might seem to present. Indeed, not only do they not aim to delineate a fixed, complete, and fully consistent position, they regard such a delineation as impossible, so noting that they fail to accomplish it does not suffice as a criticism of them. Readers, or would-be readers, of Derrida in particular often stop here, dismissing his work as so much nonsensical relativism. De Jong instead asks how we are to understand this movement that resists any fixed position and how we might critique it without taking it for a failed attempt to establish a fixed position. These questions, which de Jong addresses in an admirably nuanced fashion that makes this book well worth reading, ultimately point us to questions about justice and responsibility.
Thus we as readers find ourselves confronted with the question of what it means to read de Jong’s text responsibly. How do we engage with the impossibility of reducing it to a single determinate position about the three philosophers – G.W.F. Hegel, Martin Heidegger, and Jacques Derrida – with which it primarily deals? For what is here called a “movement” must exceed de Jong’s stated positions as it exceeds theirs. Asking “how such a discourse of movement can be understood and criticized,” he maintains that “answering this question does not, as some may think, itself require indirectness, textual extravagance, or a poeticization of philosophical method (even though these cannot in principle be excluded from the realm of philosophical efficacy)” (xxii). What, though, does it mean to say that answering a question does or does not require indirectness? “Indirectness” is the word de Jong has chosen to name the “undercutting gesture” by which “Derrida’s claims and conclusions are invariably repeated, reversed, retracted, contradicted, visibly erased, or otherwise implicitly or explicitly complicated” according to the movement that cannot be contained within any fully determined position (xxii). Yet if indeed thought itself cannot be thus contained – if any position that one might suppose to be fully determined in fact always already undercuts itself – then it is less a matter of indirectness being required than of indirectness being impossible to avoid, at least in implicit form, no matter how hard one tries. De Jong’s style does differ considerably from Derrida’s; readers who regard Derrida’s style, or styles, as obfuscatory should not be able to make the same complaint about de Jong’s, and if they read The Movement of Showing they ought, moreover, to come away with a better understanding of why Derrida wrote as he did. That said, de Jong implicitly recognizes that indirectness is also at work in his own book when he writes that “the very term ‘indirect’ is itself also not the adequate, definite, final or right word for what is investigated here” (xxii). I will return, at the conclusion of this review, to the question of indirectness in de Jong’s text. For the moment, let us note that the impossibility of finding any “adequate, definite, final or right word” will be a recurring theme throughout, and it is one that we must bear in mind when reading any text, whether a book by Derrida, The Movement of Showing, or, for that matter, this review. At the same time, we cannot escape words, however inadequate and indefinite they may be, nor should we desire to – and the joint impossibility and undesirability of such an escape will prove central to ethical responsibility.
Part I, “Sources of Derrida’s Indirectness,” examines, with remarkable nuance and precision, Derrida’s manner of writing. In chapter 1, De Jong begins by arguing that, contrary to what some commentators have supposed on the basis of certain of Derrida’s more direct assertions, Derrida does not and cannot offer a theory of language. Readers of Of Grammatology at times make the mistake of deriving a theory of language from it, which they then attribute to Derrida, according to which speech, traditionally considered superior to writing because of its immediacy, is in fact just as mediated as writing and should therefore be understood as arche-writing, or writing in a more general sense of the term. Derrida’s point, however, is that this theory is already in Ferdinand de Saussure’s Course in General Linguistics, Saussure’s intentions to the contrary notwithstanding. Taking it as Derrida’s theory fails to understand that there can be no definitive theory of language. Arche-writing is not writing understood more broadly, as if we could fully understand language once we worked out the proper definition of “writing”; rather, it marks the impossibility of attaining some ideal meaning that would be unmediated and fully present. Derrida does not offer a theory, explains de Jong, but seeks rather to show the movement that reveals the limits of all theories, even as they try to present themselves as complete.
Readers of Derrida who recognize that neither he nor anyone else can offer a complete and consistent theory of language often interpret him as an opponent of metaphysics, but de Jong shows in chapter 2 that this interpretation also fails. There is no way out of metaphysics, and Derrida does not propose to offer one. Seeking to overcome metaphysics is itself metaphysical, for any attempt to get outside metaphysics already depends on metaphysics to define itself. What is more, the history of metaphysics is the history of this attempted overcoming. Questioning metaphysics is not, therefore, a matter of opposition, and this questioning even calls itself into question precisely because any attempt to think metaphysics necessarily occurs within the language of metaphysics. That theories are limited in no way entails that we can step outside or overcome their limits.
Having demonstrated the problems with certain popular interpretations of Derrida’s texts – that he offers a theory of language and that he calls for the overcoming of metaphysics – de Jong asks, in chapter 3, whether Derrida can be justified. If Derrida argues that all positions are incomplete and undo themselves, then pointing to omissions or inconsistencies in his work hardly serves to refute him, but it is equally unclear what grounds one might find to justify a work that disclaims the very attempt to produce a complete and consistent position – and de Jong insists that Derrida’s would-be defenders must recognize the latter point just as much as the former. It is not that Derrida makes a virtue of mere contradiction, as if one ought to embrace inconsistency itself as final and definitive. But de Jong emphasizes that “Derrida cannot be completely safeguarded against the accusations from which his works must nevertheless be tirelessly distinguished” (76). Derrida is not the mere relativist that he has often been accused of being, and yet “the risk of assimilation and supposed misreading is not an extrinsic one, but intrinsic to the operation of deconstruction” (78). There is a real sense, therefore, in which Derrida cannot be justified – which is not to say that his work can be dissociated from justice (a point to which de Jong will return). De Jong warns us against the “reassurance mechanism” that consists in saying, “Never mind [Derrida’s] critics; they clearly haven’t read the texts” (78). The point is apt, but I suggest that one might ask the critics whether they have read their own texts. For a more careful reading might show them that misreading and reading can never be neatly separated; nor, for that matter, can writing and what one might call miswriting. As deconstruction operates within any text, it is not only Derrida’s texts that cannot be safeguarded from any possibility of misreading – and this point is one that merits greater emphasis than de Jong gives it in this chapter. He rightly points out what he calls the vulnerability of Derrida’s texts, at the risk of suggesting that Derrida’s texts are unusually vulnerable. Still, Part I is an excellent reading of Derrida, and since reading and misreading cannot be disentangled, there is no way to exclude every possible misinterpretation. De Jong’s argument that Derrida does not call us to overcome metaphysics, as if going beyond metaphysics were possible, is a particularly valuable contribution to the literature.
De Jong now turns to Hegel in Part II and then to Heidegger in Parts III and IV. Since Derrida cannot be outside the metaphysical tradition, his relation to Hegel and Heidegger cannot consist, as it has often been thought to do, in rejecting them as still too metaphysical. This reexamination of Hegel and Heidegger thus follows from the analysis in Part I, and it shows that they are rather less different from Derrida than they are generally imagined to be – without, however, assimilating them into a single position. All three thinkers reveal the limits of any thought that seeks to establish a fixed position, while they also recognize that we cannot step outside or beyond the limits of thought itself.
Part II, “Movement and Opposition,” begins with the argument, in chapter 4, that for Hegel as for Derrida, philosophical questioning cannot itself be detached from its object. Indeed, de Jong writes that “Hegel is the first philosopher to explicitly locate the aforementioned entanglement right at the heart of the philosophical enterprise” (85). It is for this reason that philosophy cannot arrive at a conclusive end to its investigations: philosophy is always investigating itself. Hegelian dialectic is often interpreted to mean that philosophy will progressively free itself from its own limits and reach Absolute Knowing, a final position in which alterity is no more, and Derrida’s own readings of Hegel have fueled this misconception. Through a consideration of the development of Hegel’s thought, de Jong shows that Hegel does not propose that philosophy’s movement can or should be brought to a halt. Precisely because the absolute is not the cessation of movement, “Hegel’s ‘absolute’ idealism must be interpreted as an affirmation of the limits of reflection” (121): reflection does not transcend its limits but is carried along within them, and it is within its limits that it finds itself haunted by the alterity that can never be made fully present.
What, though, of Derrida’s own readings of Hegel, in which Derrida seems to regard Hegel as an opponent of alterity and himself as an opponent of Hegel? De Jong turns to this question in chapter 5 and argues, without denying the differences between the two philosophers, that Derrida’s relation to Hegel is not, and cannot be, one of simple opposition. In any case, opposition is never simple, since the sides of a dichotomy are necessarily dependent on each other to the very extent that they are defined by their opposition. What is more, Derrida offers multiple readings of Hegel – or, to put it another way, the name “Hegel” does not stand for the same figure every time it appears in his texts. At times, as for instance in “Tympan,” it does stand for a figure who seeks to eliminate the risk posed by negativity or alterity – but “Tympan” is less a supposedly definitive reading of Hegel and more an attempt “to stage a confrontation of philosophy with that in which the philosopher would not recognize himself, not so foreign to philosophy as to leave it undisturbed, and not so close to philosophy as to do no more than repeat it” (134). It is, in short, an attempt to call attention to philosophy’s limits so that it will not mistake itself for the final, complete answer. Derrida’s target is not Hegel but a complacent Hegelianism that believes that all that is worthwhile is, or at least can be, subjected to its comprehension. Reading “Hors livres, préfaces” in Derrida’s Dissemination, de Jong finds that Derrida first describes the Hegel of Hegelianism before coming to the Hegel who is a thinker of movement and of difference – a Hegel who is not Derrida but in whom Derrida finds a “point of departure” (149) that is not simply the basis for opposition. Or, as de Jong puts it, “Derrida needs Hegel’s ‘speculative dialectics’ as a point of contrast, but he is aware that Hegel cannot be reduced to those terms. […] The more radical [sic] Derrida presents himself as moving beyond Hegel, the more emphatically his allegiance to Hegel is reaffirmed” (151). Derrida needs Hegel because of how Hegel can be read and misread: the thinker of movement who has been misinterpreted as a thinker of overly definitive absolutism is a fitting interlocutor for another writer who, precisely because he is also a thinker of movement, is profoundly concerned with questions of interpretation, questions of reading, misreading, and the complex interplay thereof. Indeed, one should not suppose that reading and misreading are independent and readily distinguishable – a point implicit in de Jong’s insistence on the impossibility of safeguarding Derrida from misreadings.
Part III, “Heidegger: The Preservation of Concealment,” reads Heidegger’s Being and Time and Contributions to Philosophy (Of the Event) in order to explore the theme of indirectness in Heidegger. In chapter 6, considering Heidegger’s criticisms of the language of Being and Time, de Jong argues that the problem was not that the language of Being and Time failed by remaining too much within metaphysics, nor can the Kehre be understood as a turn to looking for a language that would adequately say being. Rather, the language of Being and Time was, in Heidegger’s later view, insufficiently attentive to the inevitability of a certain failure, and Heidegger came to seek “a language that would take into account, recognize, and preserve a certain necessary failure-to-say with respect to (the question of) being” (156). This language would still be metaphysical since the overcoming of metaphysics is itself metaphysical, but it would strive to reveal the very impossibility of finding a location outside metaphysics from which to philosophize. Already in Being and Time questioning is no straightforward matter, however: that Dasein questions being from within being is crucial to the book – an obvious point in itself, but what has been neglected is that the middle and late Heidegger’s works, including those written post-Kehre, therefore represent not a break with his early thought but a deepening of themes and problems that were in play from the start.
Chapter 7 pursues this analysis via a reading of the Contributions. De Jong emphasizes that the forgetfulness of being is neither a problem that can be solved nor an error that can be fixed. Heidegger’s goal is not and cannot be to overcome this forgetfulness but is “to recognize and preserve that forgetfulness as such, or interpret it originally” (200). Indeed, overcoming the forgetfulness, as though it could be left behind, would amount to forgetting it again. What is essential is that we strive not to forget the forgetfulness, that we strive to recognize the limits of thought – which is precisely not stepping beyond them as if they could become negligeable. This recognition, moreover, is a movement that never becomes a completed process.
Part IV, “Of Derrida’s Heideggers,” shows that Derrida’s relation to Heidegger, like his relation to Hegel, is not simply a matter of opposition. In Derrida’s texts, the name “Heidegger” is no more univocal than the name “Hegel.” Chapter 8 explores this complex relation through a reading of Derrida’s Spurs: Nietzsche’s Styles. The key point is that Heidegger’s reading of Nietzsche risks closing off the meaning of Nietzsche’s texts by arriving at some result that is then taken as definitive and final, yet Heidegger’s texts cannot themselves be closed off by interpreting them once and for all as the refusal of indirectness and undecidability. And as de Jong observes, “[Derrida] does not make a simple choice between these two Heideggers. The virtue of that undecidability lies in its potential to open the texts of these thinkers and resist reducing them to the content of an unequivocal thesis” (240). This remark also has worthwhile implications for the question of what it might mean to critique Derrida, though de Jong does not make them wholly explicit: that Derrida cannot be reduced to a purveyor of definite theses means that there are multiple Derridas, and a fruitful critique – fruitful in that it would recognize the limits of thought without seeking to go past them – would then be one that draws out this multiplicity rather than presenting a univocal Derrida who is assigned the role of opponent.
Chapter 9, turns, finally, to the question of responsibility. Here the question of critique or justification gives way to the question of justice. De Jong notes that “in the debate about the ‘ethics of deconstruction,’ interpretations have tended to work within a Levinasian framework, which understands ethics primarily with reference to the ‘other.’ That is quite right, but there is a risk if the other is confused with the external” (242). It is worth explicitly noting what is implicit here: that the other in Levinas is not a matter of externality, as alterity would then be one pole of the externality-internality dichotomy and so would fall within totality. In any case, de Jong’s analysis, which emphasizes complicity and proceeds through a reading of Derrida’s Of Spirit, is excellent. De Jong recognizes the indirectness of Derrida’s texts as a gesture of responsibility. What might appear as an irresponsible refusal to be associated with any position, and hence as a withdrawal from potential criticisms, is an attempt to grapple responsibly with the failure of any position – yet it is a responsibility that can never escape its own complicity with those failures. Heidegger’s own complicity has struck many as uniquely grave, and de Jong notes that Derrida does regard Heidegger’s use of the term Geist, in his 1933 rectorial address, as complicit with Nazism. It does not follow, however, that we can purify our own thought by rejecting Heidegger; Derrida himself cautions us against such an attempt to achieve purity. For Heidegger’s complicity with Nazism took place, writes de Jong, “by way of a mechanism or a ‘program’ of complicity and reaffirmation that Derrida himself does not claim to be able to escape. The program itself consists in the very attempt to escape, the thought that one can exceed racism or biologism by elevating oneself above it to a position of reassuring legitimacy” (251). More broadly, the quest for absolute purity cannot be untangled from a drive to declare oneself innocent – that is, not complicit in anything or, to put it another way, not responsible. But “the ‘fact’ that not all forms of complicity are equivalent” (252) does not mean we can avoid complicity, that we can overcome or go beyond it. We are responsible in advance, inescapably responsible, unable to establish a position that would justify us, free us from complicity, and let us relax in the security of non-responsibility. De Jong’s emphasis on complicity ties back to his earlier argument that Derrida’s texts cannot be made safe from misreading. By resisting the opposition between Derrida’s critics and his defenders, de Jong resists the temptation to safeguard thought, thereby reminding us of our limits. It is because we will never be able to present the truth, the whole truth, and nothing but the truth, as the saying goes, that we are complicit – which is a call not to despair but to the responsibility that, as de Jong’s The Movement of Showing skillfully reminds us, we cannot evade.
An afterword begins by addressing the question of indirectness in de Jong’s own text, and here he proves a less skillful reader than he did when interpreting Hegel, Heidegger, and Derrida – though his failings are instructive and perhaps unsurprising, given that we cannot escape complicity with the attempt to arrest the movement of showing to arrive at some fixed position. De Jong asks “why, if [he] ha[s] been successful, [his] own exposition will not have displayed the implicit or explicit self-complication that has been [his] theme” (264). One response, which he admits is “facile,” is that “[he] ha[s] set out to do nothing more than to provide a commentary, and to provide a way of reading that goes against certain ideas about how to interpret the work of Hegel, Heidegger, and Derrida. […] There is no reason why that reading could not be explicated unequivocally” (264). Granted, he himself calls this response “facile,” yet that it should be offered at all indicates the durability of the opposition between a commentary and the work commented upon, with the commentary appearing as merely secondary and derivative. Derrida, let us recall, commented on works by Hegel and Heidegger, and as I noted above, de Jong’s own analysis suggests (though without explicitly saying so) that there are multiple Derridas, as there are multiple Hegels and Heideggers. I do not mean to suggest that all Derridas, Hegels, or Heideggers on whom one might comment are equally valid or fruitful. The Derridas, Hegels, and Heideggers whom one encounters in de Jong’s text are remarkably well interpreted, whereas, to take an extreme example, anyone who attempts to read Of Grammatology as a guide to birdwatching is likely to be disappointed. Consider, however, Derrida’s remark in “Des tours de Babel,” concerning translation, that “the original is the first debtor, the first petitioner; it begins by lacking [manquer] – and by pleading for [pleurer après] translation” (Derrida 2007, 207). The so-called original text never stands on its own but is already a translation, is already separated from itself by its inevitable equivocity. Commentary is not exempt from this condition: it is never “nothing more than […] commentary.” De Jong’s writing is clear in that it is easy to follow – easier than Derrida’s, Hegel’s, or Heidegger’s often is – but that does not mean it is univocal. Commentary too is separated from itself – and, moreover, it is a way of translating the so-called original. The texts signed by Hegel, Heidegger, or Derrida call out for commentary because they are not summed up in what they say – nor in what any commentary or translation could say. The commentary and the translation plead as well, and they are not safe from misreading. Whether de Jong’s text displays self-complication and whether it does complicate itself are two different questions, and besides, one might well argue that it does display self-complication precisely by calling our attention to our inevitable complicity.
De Jong offers, as a “more principled answer,” the reply that “an awareness of the performative complexity of philosophical texts does not in itself necessitate a specific style” (265). This answer still tends to assume that self-complication must be blatantly visible as such, but de Jong rightly observes that “it is not a matter of doing away with representation or opposition, nor with the traditional form of an academic treatise. At issue is precisely an ‘inner excess,’ or how in what presents itself as proposition, representation or claim, something more, less, or other than what is ‘posited’ in them is taking place” (265). Indeed. Derrida’s styles are not the only ones in which worthwhile thinking may occur. And as there are multiple Derridas, there are multiple de Jongs, whom this review certainly does not exhaust, and I recommend that anyone interested in Hegel, Heidegger, Derrida, or questions of indirectness more broadly read The Movement of Showing and encounter them for him- or herself. If I have dwelt at some length on the brief and admittedly “facile” response, and if I still reproach the “more principled” response with suggesting, in defense of the book’s clarity, that it is possible to avoid self-complication through the choice of a particular style, it is to highlight a certain complicity with the overly definite and determinate that inevitably accompanies writing. Indirectness cannot, however, simply be opposed to directness, as if one were pure and the other not – a point de Jong does not make explicit but that he could well have. Complicity with the overly definite and determinate is the only way to speak or write at all, and refusing to speak or write out of a desire for purity is an attempt to abdicate responsibility.
Indeed, de Jong in his afterword goes on to observe that “even given the limitations of the propositional form, of representation, and of oppositional determination, it is in and through them that we can and in fact do say more, less, or something else than what is merely ‘contained’ in those determinations” (272). Hence the limits of language are not to be regretted, which is a crucial point. Thus de Jong refuses to take “a negative or skeptical view on language as inadequate or as failing,” calling instead for “a productive view on propositions and claims such that they might carry or co-implicate more than the content that is ‘contained’ in them” (272, emphasis in original). That a text is “lacking,” to recall the above quotation from “Des tours de Babel,” does not mean that it has failed, as though it would have been better for it to lack nothing so that there was no call for translation’s creativity. Complicity does not put an end to creativity – far from it. Because there is no manual telling us precisely how to live out the responsibility by which we are committed in advance, our responses must be creative ones. One of the virtues of The Movement of Showing, though by no means the only one, is that it warns us against considering language—and hence what is expressed through language—a failure because of its limits, and that it points out that language even owes its richness to those very limits. In short, The Movement of Showing is a text that rewards attentive reading, and it makes a valuable contribution to the field.
Reference
Derrida, Jacques. 2007. “Des tours de Babel.” Translated by Joseph F. Graham. In Psyche: Inventions of the Other, vol. 1, edited by Peggy Kamuf and Elizabeth Rottenberg. Stanford: Stanford University Press.
 Comprendre Heidegger. L'espoir d'une autre conception de l'être
Comprendre Heidegger. L'espoir d'une autre conception de l'être
Reviewed by: Karl Racette (Université de Montréal)
Publié une trentaine d’années après le très important livre Le tournant dans la pensée de Martin Heidegger (Épiméthée, 1987), Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être (Hermann Éditions, 2019) est la deuxième monographie de Jean Grondin portant exclusivement sur la pensée de Martin Heidegger. La publication de cet ouvrage aura précédé de peu La beauté de la métaphysique (Éditions du Cerf, 2019) publié le même été. La réception francophone de Heidegger aura été ainsi très comblée lors de la dernière année par ces deux ouvrages de J. Grondin qui, à plusieurs égards, pourront être lus de manière complémentaire.
Dès les premières lignes de l’ouvrage, l’A. affirme qu’il faut comprendre Heidegger d’abord et avant tout à partir de sa question essentielle, celle de l’être[1]. Cette exigence de compréhension apparaît prioritaire aux yeux de l’A. compte tenu de sa réception récente, qui s’est surtout concentrée sur l’engagement politique de Heidegger, prompte à discréditer d’emblée sa pensée. Comprendre Heidegger, nous dit J. Grondin, c’est à la fois comprendre son effort indéfectible de penser l’être, mais c’est aussi « comprendre sa personne et son engagement politique »[2]. L’approche de l’A. est au départ originale en ce qu’elle ne sépare pas l’homme de l’œuvre en vue de sauvegarder l’œuvre, mais tente plutôt de comprendre l’engagement politique de l’individu Heidegger à partir de la question qui anime l’œuvre, celle de penser à nouveau l’être.
C’est à cet effet que J. Grondin déploiera un double effort de compréhension – celui de la fusion des horizons, héritée de Gadamer et de transposition reprise de Schleiermacher – qui aura chacun l’œuvre et l’homme comme objet[3]. Nous pouvons dire que les chapitres 1 à 7 consistent en un effort de compréhension, se rapprochant de la fusion des horizons gadamérienne dans la mesure où les différentes interprétations proposées comportent toujours un moment de confrontation critique envers Heidegger. De leur côté, les chapitre 8 à 10 sont plutôt un effort de transposition dans l’horizon d’attentes de Heidegger où il s’agit de comprendre l’homme Heidegger selon ses projets, ses attentes, ses espoirs, etc. La visée de cette transposition étant surtout de comprendre les raisons personnelles qui ont poussé Heidegger à se reconnaître dans le national-socialisme. Ce double effort de compréhension possède néanmoins une visée commune : montrer que l’auteur et l’individu sont orientés par la même « étoile » qui guide toujours leur engagement spirituel et personnel, la question de l’être.
L’effort de compréhension de l’ouvrage est orienté par quatre présupposés de lecture que l’A. expose dès l’introduction. D’abord (1), il faut, comme nous l’avons dit, comprendre Heidegger (l’œuvre et l’homme) à partir de la question l’être : « Heidegger soutient à bon droit qu’elle est sa question essentielle, voire la seule question (au sens où tout dépend d’elle), mais aussi la question fondamentale de la pensée occidentale, voire de la pensée tout court, et qu’elle est tombée dans l’oubli dont il est opportun de la tirer »[4]. Si ce présupposer va de soi pour l’œuvre de Heidegger, cela semble être le pari de l’interprétation proposée par J. Grondin de la compréhension de l’homme Heidegger. Une bonne partie de l’ouvrage (en particulier les chapitres 8 à 10) cherche à montrer qu’il faut comprendre les raisons de l’engagement politique de Heidegger à partir des exigences théoriques et « pratiques » de sa propre philosophie. La motivation commune entre la pensée de l’auteur et son engagement politique réside dans le fait que (2) « notre conception de l’être reste dominée par une certaine intelligence de l’être qui est préparée de longue date, en vérité depuis les Grecs, mais qui est problématique et qui n’est peut-être pas la seule »[5]. Dans la perspective de Heidegger, nous explique l’A., il est nécessaire de penser et de préparer un autre rapport possible à l’être – le nôtre étant sous l’emprise de la compréhension de l’être envisagé comme « étant subsistant qui est immédiatement présent, observable, mesurable et utilisable »[6]. Ce que l’A. rend visible sans équivoque c’est que cette compréhension techniciste et calculante de l’être est « largement responsable du nihilisme et de l’athéisme contemporain »[7]. C’est dans ce combat « héroïque et parfois pathétique »[8] qu’il faut comprendre à la fois l’œuvre philosophique de Heidegger et l’engagement politique de l’homme (3). C’est dans cette recherche d’un nouveau commencement de la pensée, qui consiste en une préparation lente et difficile d’une autre entente de l’être, que Heidegger a pensé avoir trouvé dans le nazisme, de manière pour le moins illusoire et fatale, l’une des possibilités historiques de cet autre compréhension de l’être, dont il voulait être le prophète. Ces trois hypothèses de lecture permettent la quatrième (4) : « le débat de fond avec Heidegger se situe donc moins au plan politique, qui continuera assurément d’obséder les médias et l’opinion, qu’an plan métaphysique »[9]. En ramenant le débat en terres métaphysiques, l’A. espère ainsi préserver la pertinence philosophique de la pensée heideggérienne de l’être. Cela ne veut toutefois pas dire que l’ouvrage est une simple apologie de Heidegger, au contraire : si J. Grondin ramène Heidegger sur le plan de la métaphysique, c’est dans la perspective de rendre possible une interprétation critique de sa pensée. Nous y reviendrons.
En plus de l’introduction, l’ouvrage est divisé en trois parties qui forment ensemble dix chapitres. Neuf des dix chapitres sont des reprises de certains textes que l’A. a publié dans le passé, de 1999 à 2017. À ceux-ci s’ajoute un texte inédit (chapitre 10) sur l’engagement politique de Heidegger. Bien que la majorité des textes ont été écrits dans un temps, une thématique et un contexte différent, ces derniers ont été retravaillés selon l’orientation principale du livre, c’est-à-dire celle de comprendre Heidegger selon sa question essentielle. L’ouvrage peut donc être lu de façon linéaire pour avoir de multiples perspectives sur le projet de Heidegger. Les différents chapitres gardent néanmoins une certaine autonomie et pourront aussi être lus individuellement.
La première partie de l’ouvrage intitulée « l’urgence de dépasser la conception dominante de l’être » (chapitres 1, 2, 3 et 4) propose une certaine introduction générale à la pensée de Heidegger, ainsi qu’aux thèses principales de Sein und Zeit. Un lecteur familier de l’A. y trouvera les principes et les thèses habituellement exposés dans ses autres ouvrages portant soit sur l’herméneutique ou la métaphysique. Ces chapitres constituent une bonne introduction à la pensée de Heidegger, écrits dans un style qui évite tout jargon, en ayant le soin de traduire Heidegger en une langue lipide et claire, ce qui est en soi un défi immense.
Le premier chapitre « Pourquoi réveiller la question de l’être ? » propose une lecture des premiers paragraphes d’Être et temps. En replaçant l’ouvrage de 1927 dans le contexte historique et philosophique de son époque, l’A. relit le premier chapitre du texte en soulignant les raisons qui poussent Heidegger à reposer (répéter pourrions-nous dire) la question de l’être. Cette relecture de l’intention d’abord et avant tout ontologique du texte sert sans doute à justifier les hypothèses de lecture proposées par l’A. en venant rappeler aux lecteurs les formulations fondamentales du projet heideggérien en 1927, celui d’un « réveil » de la question de l’être. Ce chapitre est certainement utile à quiconque cherchera à s’introduire à la pensée heideggérienne ou à Être et temps, en démontrant que l’être est sans contredit l’objet principal de la pensée de Heidegger – ce qui ne va pas toujours de soi, comme c’est le cas dans la lecture « pragmatique » d’Être et temps que l’on retrouve souvent dans la réception anglo-saxonne de Heidegger.
Le second chapitre « Comprendre le défi du nominalisme » est pour sa part beaucoup plus proche d’une interprétation critique de Heidegger. L’A. esquisse les raisons de la remise en question heideggérienne de la conception de « l’étant subsistant » qui représente la condition de possibilité ontologique de « l’essor de la technique »[10]. De manière très claire et convaincante, l’A. expose la continuité entre les questions métaphysiques et techniques de Heidegger. La particularité de la lecture de J. Grondin tient à l’exposition de certaines de ses réserves par rapport à la conception heideggérienne de la métaphysique. C’est que, nous explique l’A, le concept heideggérien de métaphysique ne serait-il pas lui-même « un peu technique, passe-partout, […], qu’il [Heidegger], applique péremptoirement à l’ensemble de son histoire, mais qui finit par rendre inaudibles les voix et les voies de la métaphysique elle-même ? »[11]. Plutôt que de s’attaquer à la métaphysique, l’A. préfère plutôt parler de conception « nominaliste »[12] de l’être qui serait responsable des conséquences que Heidegger déplore. Dans la continuité de son livre Introduction à la métaphysique – dont J. Grondin avoue lui-même être « un modeste contrepoids à l’ouvrage du même nom de Heidegger »[13] – il affirme plutôt qu’il est possible de trouver au sein même de la richesse de la tradition métaphysique le remède contre l’expérience moderne du nihilisme.
Le troisième chapitre « Comprendre pourquoi Heidegger met en question l’ontologie du sujet afin de lui substituer une ontologie du Dasein » cette fois-ci retourne à Être et temps en vue de rappeler à quelles fins Heidegger tente de penser l’homme non pas comme sujet, mais comme « espace » où se pose la question de l’être, Da-sein. La particularité de la lecture que propose l’A. réside certainement dans sa mise en rapport des concepts de Heidegger avec la richesse de la conceptualité grecque, son histoire et ses transformations. Dans cette perspective, il devient clair que le projet de l’analytique transcendantal de 1927 est une réponse à la conception de la métaphysique moderne de l’homme, ce que l’auteur souligne justement.
Le quatrième chapitre « Comprendre la théorie de la compréhension et du cercle herméneutique chez Heidegger » expose de manière détaillée l’apport de l’herméneutique (en 1927 et au-delà) au projet ontologique de Heidegger. Il expose certains des concepts les plus canoniques de Heidegger comme la compréhension, le pouvoir-être, l’explicitation (ou l’interprétation, Auslegung) ainsi que le cercle de la compréhension. En montrant que l’herméneutique heideggérienne est toujours orientée vers la question de l’être. L’A. en profite pour souligner certaines des apories de sa pensée.
La seconde partie de l’ouvrage s’intitule « Dépasser la métaphysique pour mieux poser sa question » et comporte les chapitres 5, 6 et 7. Dans ces chapitres, l’A. interprète certaines thèses de Heidegger de manière très soutenue. En interprétant ligne par ligne certains des textes de Heidegger, l’A. y propose une lecture critique, souvent en réactualisant la tradition métaphysique (principalement platonicienne et sa descendance) contre l’interprétation heideggérienne de la métaphysique jugée réductrice. C’est précisément à cet endroit que l’ouvrage La beauté de la métaphysique publié la même année pourra être éclairé tout en éclairant la lecture proposée par l’A. de la pensée heideggérienne. La défense de la métaphysique de l’A. dans cet autre ouvrage nous permet de mieux comprendre à partir de quel horizon l’interprétation heideggérienne de la métaphysique est critiqué : « La métaphysique, dans son ontologie, sa théologie et son anthropologie, nous permet ainsi d’espérer que l’existence est elle-même sensée. C’est ‘en ce sens’ que la métaphysique, avec toute sa riche histoire, représente le bienfait le plus précieux de l’histoire de l’humanité »[14]. Les chapitres dont il est question sont donc à la fois importants en ce qu’ils restituent de manière convaincante et rigoureuse la visée du projet de Heidegger, ses espoirs, tout en proposant une lecture critique qui saura nous renseigner sur les possibilités de la métaphysique et de l’herméneutique contemporaine.
Le cinquième chapitre « Heidegger et le problème de la métaphysique », qui est de loin le plus long du livre (environ 70 pages), s’intéresse à la question de la « destruction » heideggérienne de la métaphysique, d’Être et temps jusqu’à sa toute dernière philosophie. Il s’agit là d’un chapitre très chargé et ambitieux à plusieurs égards, car l’auteur aborde une multiplicité de textes de Heidegger en y soulignant la transformation (ou le « tournant ») dans sa conception de la métaphysique. Bien que le thème de ce chapitre est en soi ardu, l’auteur explique la progression des réflexions de Heidegger au sujet de la métaphysique toujours de manière claire et argumentée en référent de façon tout autant pédagogique que minutieuse aux différents livres, essais, conférences et cours de Heidegger. En esquissant la conception heideggérienne de la métaphysique, l’A. termine sur les possibilités de la métaphysique rendues ouvertes par le projet « destructeur » de Heidegger. L’apport de Heidegger, aux yeux de J. Grondin réside « moins dans l’élaboration d’une nouvelle pensée de l’être, que dans la destruction des évidences de la raison calculante et nominaliste. La métaphysique peut nous apprendre qu’il ne s’agit pas de la seule conception de la raison et de l’être qui soit possible »[15]. Dans la continuité du deuxième chapitre, l’A. voit moins en la métaphysique le responsable du nihilisme contemporain que dans la conception nominaliste de l’être. L’apport de Heidegger réside dans cet espoir de rendre une autre conception de l’être possible, autre conception que l’A. retrouve dans les richesses de la pensée métaphysique.
Le sixième chapitre « Le drame de la Phusis, loi secrète de notre destin » est assurément le chapitre le plus critique de l’ouvrage et en ce sens, l’un des plus fécond. L’A. interprète ligne par ligne la compréhension heideggérienne de la Phusis exposée dans son cours Introduction à la métaphysique (GA 40), par-delà sa traduction latine et sa reprise moderne dans le terme de nature. À l’aide de la richesse des paroles de la pensée métaphysique (exprimée dans une pluralité de langues), l’A. s’attaque directement aux présupposés qui guident la dévalorisation des concepts métaphysiques dérivés (latin et modernes) ainsi qu’à la valorisation de l’expérience présocratique (et donc pré-métaphysique) de l’être, la seule qui serait véritablement « pure » ou « originaire ». La qualité de la critique de l’A. tient au fait qu’elle se réalise au sein même de la pensée heideggérienne et non à partir d’un horizon étranger – témoignant ainsi d’un véritable dialogue entreprit avec l’auteur allemand. Il s’agit d’une véritable confrontation avec la pensée heideggérienne où l’A. souligne certains présupposés néfastes propres à la compréhension heideggérienne de la métaphysique[16].
Le septième chapitre « Gerhard Krüger et Heidegger. Pour une autre histoire de la métaphysique » bien que dans la continuité des précédents chapitres, possède une certaine autonomie. Il s’agit d’une introduction générale à la pensée de Gerhard Krüger, « l’un des élèves les plus doués de Heidegger »[17]. À partir de la pensée de Krüger et sa correspondance avec son maître Heidegger, l’A. aborde le projet de Krüger comme reprise critique de la pensée de Heidegger à propos de la thématique religieuse, qui est omniprésente dans l’ouvrage de J. Grondin. La pensée de Krüger peut certainement être comprise comme étant dans la continuité de la brèche ouverte par le questionnement religieux de son maître. Ce chapitre est dans la continuité des autres chapitres de la partie deux, en ce qu’il offre une lecture critique de Heidegger dans la mesure où l’A. voit en Krüger un allié de son projet, puisqu’il « rappelle ainsi la métaphysique à certaines de ses possibilités immortelles »[18].
Les chapitres 8, 9 et 10 sont probablement ceux qui intéresseront le plus l’« opinion publique », pouvons-nous dire, puisqu’ils abordent de front la question de l’engagement politique de Heidegger. Ils forment ensemble la troisième partie de l’ouvrage intitulée « La tragédie politique ». En abordant la question de l’engagement politique de Heidegger à partir du contexte historique de son époque, l’auteur esquisse les causes philosophiques, historiques et biographiques qui expliquent l’affiliation de Heidegger au partie nazi dans les années 30 et au-delà.
Le huitième chapitre « L’ontologie est-elle politique ? La question de la vérité dans la lecture de Heidegger par Bourdieu » expose les critiques sociologiques de Bourdieu envers toute ontologie ignorant ses présupposés politiques. Dans L’ontologie politique de Martin Heidegger, Bourdieu vise à dégager « le caractère secrètement ‘politique’ de la pensée de Heidegger, mais aussi de la philosophie en général »[19]. Contre la lecture proposée par Bourdieu de l’ontologie, l’A. défend plutôt l’idée d’un « arrachement ontologique » face aux « considérations partisanes » politiques[20]. Le chapitre peut être compris selon deux autres visées : celle de remettre en contexte le questionnement ontologique de Heidegger (dans la continuité du reste de l’ouvrage), ainsi que de produire une critique de la lecture de Bourdieu de l’ontologie heideggérienne[21]. Si l’ontologie a souvent besoin de se justifier face aux questionnements sociologiques, l’un des mérites de ce chapitre est de questionner la sociologie à partir de ses présupposés ontologiques. En ce sens, reprocher à Heidegger que sa limitation aux questions ontologiques l’empêche de questionner « l’essentiel, c’est-à-dire l’impensé social »[22] c’est affirmer que « l’impensé social » est une pensée plus essentielle que la question de l’être. Cela revient à dire qu’il y a « une dimension essentielle de la réalité » qui est négligée et qui doit ainsi être pensée. Or, nous dit l’A., cette prétention de Bourdieu « n’est plus sociologique, mais purement ontologique »[23]. S’il est nécessaire de débattre avec Heidegger, ce doit être à propos de la vérité ou non de ses thèses ontologiques, ce que l’A. entend entreprendre dans le reste de l’ouvrage.
Le neuvième chapitre : « Peut-on défendre Heidegger de l’accusation d’antisémitisme ? » s’engage dans un débat pour le moins controversé et dont toute défense de Heidegger apparaît d’emblée suspecte. L’A. se contente de mettre en contexte la pensée de Heidegger, et plus particulièrement celle que l’on retrouve dans ses cahiers noirs, dont la publication récente a ouvert encore une fois la question de son engagement politique. L’A. vient nuancer l’accusation d’antisémitisme de Heidegger en rappelant que ce sujet ne constitue que tout au plus trois pages sur les 1800 des cahiers noirs[24]. Sans amoindrir la gravité des affirmations malheureuses (c’est le moins qu’on puisse dire) de Heidegger, J. Grondin s’efforce de comprendre pour quelles raisons Heidegger a pu se reconnaître dans la propagande nazie de l’époque.
Le dixième et dernier chapitre « Comprendre l’engagement politique de Heidegger à partir de son horizon d’attente » est dans la continuité du précédent chapitre. Ce chapitre se démarque du neuvième en ce qu’il replace davantage l’engagement politique de Heidegger dans le contexte tumultueux de l’Allemagne du 20e siècle. L’A. esquisse les différents états d’âme de l’individu Martin Heidegger : ses rapprochements avec le nazisme et son soutien, sa distanciation, son antisémitisme, ses désillusions, ainsi que sa proximité indéfectible avec le « mouvement » national-socialiste par-delà ses réalisations effectives. C’est ici que les hypothèses de lecture que l’A. avait énoncés dans l’introduction trouvent leur aboutissement. Il faut comprendre l’engagement politique de l’homme Heidegger à partir de sa question essentielle et son espoir, pour le moins illusoire sinon aveugle, d’une autre pensée de l’être rendue possible à travers ce « réveil » du peuple allemand : « De ce point de vue, je pense qu’il est permis de dire que son soutien au mouvement national-socialiste fut toujours philosophique et il serait difficile de s’attendre à moins de la part d’un philosophe »[25]. Ce qui est certain pour l’A., c’est que Heidegger a identifié à tort son espoir d’une autre conception de l’être avec le national-socialisme, malgré les indices flagrants de leur incompatibilité effective. Cette transposition dans l’horizon d’attente du penseur n’est produite ni pour condamner ni pour démentir les accusations faites à son égard, mais est plutôt faite dans l’optique d’un « exercice de compréhension » qui doit comporter un élément de « charité et de pardon »[26]. Voilà peut-être la véritable finalité de l’ouvrage, qui a le mérite d’offrir un effort de compréhension sans jamais tomber dans l’apologie complaisante.
Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être s’adresse ainsi à un public diversifié. En raison de son style clair, de son exposé pédagogique et de son explication patiente, l’ouvrage, surtout dans ses premiers chapitres, est assurément une bonne introduction à la pensée de Martin Heidegger. Pour sa part, la seconde partie offre une lecture très soutenue et critique de Heidegger qui nous renseignera assurément sur la pensée heideggérienne de l’être, mais aussi et peut-être surtout, sur les limites de cette pensée. Cette partie est aussi un grand apport aux possibilités contemporaines de l’herméneutique, de la métaphysique et de leur co-articulation possible. Finalement, la troisième partie, étant plutôt une transposition (Schleiermacher) dans l’horizon d’attente de Heidegger éclaire certainement le contexte difficile de la rédaction des cahiers noirs et des déclarations condamnables que l’on retrouve en eux. Il s’agit d’un apport important pour le débat contemporain avec la pensée heideggérienne. Dans son entier, l’ouvrage n’a d’autre visée que celle de montrer que la pensée de Heidegger et l’engagement politique de l’homme ne répond toujours qu’à sa propre interrogation métaphysique. En ramenant le débat en terrain métaphysique, l’auteur propose une véritable confrontation avec Heidegger, s’ouvrant ainsi sur plusieurs possibilités à la fois passées et futures.
[1] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, Paris, Hermann Éditions « Le Bel Aujourd’hui, 2019, p. 5.
[2] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 5.
[3] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 246.
[4] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 8.
[5] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 9.
[6] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 9.
[7] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 5.
[8] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 13.
[9] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 15.
[10] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 45.
[11] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 58-59.
[12] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 48.
[13] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 59.
[14] Grondin, J., La beauté de la métaphysique, Paris, Éditions du Cerfs, 2019, p. 44.
[15] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 164.
[16] Notamment : (I) le préjugé de Heidegger négatif contre toute traduction du grec, (2) le jugement de Heidegger basé sur des sources textuels limitées, (3) la tension entre l’original et la création, (4) la négligence de Heidegger envers sa propre appartenance à certains principes du platonisme, du néoplatonisme et de l’augustinisme.
[17] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 207.
[18] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 210.
[19] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 216.
[20] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 217.
[21] L’A. développe trois critiques de la lecture de Bourdieu. Premièrement, Bourdieu, selon l’A., se rapporte souvent à Heidegger à partir de textes « de seconde main » et non aux œuvres de Heidegger. À cela s’ajoute des « erreurs flagrantes d’interprétation » que l’A. retrouve la lecture du sociologue. Deuxièmement, Bourdieu se réfère beaucoup plus à des témoignages et des anecdotes plus ou moins pertinentes qu’aux textes eux-mêmes, ne se référent jamais à la Gesamtausgabe disponible à l’époque d’écriture de son ouvrage. Finalement, Bourdieu interprète la pensée entière de Heidegger à l’aune de Kant et des néokantiens, ignorant ainsi la diversité des interlocuteurs de Heidegger.
[22] Bourdieu, P., L’ontologie politique de Martin Heidegger, Paris, Minuit, 1988, p. 199, cité par l’A.
[23] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 228.
[24] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 240.
[25] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 261.
[26] Grondin, J., Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, p. 267.
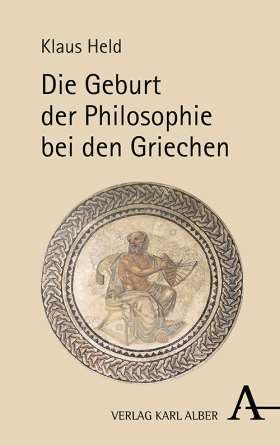 Die Geburt der Philosophie bei den Griechen: Eine phänomenologische Vergegenwärtigung
Die Geburt der Philosophie bei den Griechen: Eine phänomenologische Vergegenwärtigung